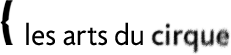Repères et réflexions
De la fin du XIXe siècle à la première décennie du XXIe siècle
par Marjorie Micucci
Pourquoi le cirque comme motif ? Comment le cirque comme motif et espace picturaux ? Quelles figures centrales – codifiées –, quels décors identifiés et définis dans une atemporalité inédite et singulière, quels espaces du cirque (de la piste, cercle clos, à la parade, populaire et hétéroclite, qui trouve ses origines dans la parade militaire) ont attiré, séduit, fasciné les artistes (des peintres aux sculpteurs, des photographes aux vidéastes, aux performeurs), de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’au début du XXIe siècle ? Avec des phases d’abandon du motif ou de désintérêt – la période des années 1940, ou encore celle des années 1950-1970, avec, bien sûr, des nuances que nous préciserons. Avec, de la part des artistes, empathie et identification. Cette empathie et cette identification qui conduisent Jean Starobinski aux analyses critiques de représentation sociale et esthétique de ce magnifique essai qu’est Portrait de l’artiste en saltimbanque (Éditions Skira, Genève, 1970, réédité en 2004 aux Éditions Gallimard, collection « art et artistes »), point d’appui également de l’une des rares expositions françaises d’envergure consacrées à cette relation entre monde circassien et univers plastiques, « La Grande Parade, portrait de l’artiste en clown », au Grand Palais, de mars à juin 2004, sous le commissariat, entre autres, de Jean Clair. Nous citerons également une autre exposition organisée, la même année, par le musée de La Chartreuse, à Douai, « Au cirque : le peintre et le saltimbanque », sous le commissariat de sa conservatrice en chef, Françoise Baligand.
Le cirque au miroir des avant-gardes et des expérimentations artistiques
Ainsi, qu’est-ce que le cirque, à partir de sa création (en 1768, en Angleterre, près de Londres), et de son extension et popularité grandissante (en France, au milieu du XIXe siècle), « donne » aux artistes, et à quels artistes ? Dans une approche réaliste, allégorique ou symbolique. Et qu’est-ce que les artistes « font » au cirque et du cirque, ainsi qu’à ses principaux protagonistes, à ses figures récurrentes, stylistiques ou chorégraphiques, qui jouent dans l’espace avec les oxymores de l’équilibre et du déséquilibre (voire jusqu’au vertige), de la légèreté et de la pesanteur, de la fixité et du mouvement, de la joie et de la tristesse, de l’apparition et de la disparition ? Que font-ils ces artistes dans et par le geste de création et de représentation qui est le leur, avec le(s) médium(s) qui est/sont le(s) leur(s) ? D’un survol, bien sûr, trop bref, il semble que cet univers du cirque rencontre à chaque période de l’histoire de l’art récente les mouvements ou les courants artistiques les plus novateurs et expérimentaux : d’un romantisme qui, par l’expression d’une sensibilité nouvelle, rompt avec la représentation classique, à la modernité des avant-gardes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, jusqu’à l’époque contemporaine et ses problématiques de genre – et c’est peut-être une hypothèse de travail que de tisser, à travers certaines œuvres contemporaines, un lien entre figures circassiennes et gender studies.
Le cirque et ses figures seraient ce lieu marge (ce qui ne signifie pas qu’il ne soit pas un lieu codé) à partir duquel la société (en l’occurrence moderne et occidentale) se rêve, se regarde, s’inquiète, se travestit, se décompose, et se rejoue dans un acte à la fois moderne et contemporain (plutôt que post-moderne) de déconstruction des normes sociales, idéologiques, sexuelles et culturelles. Le monde circassien permettrait ainsi aux artistes à la fois la construction et la fragmentation de portraits et d’autoportraits dans une mise en abyme et en double du jeu complexe des normes qui se lisent en miroir ou en positif/négatif.
Le cirque et ses acteurs : nouveaux espaces pour l’art moderne
Nous voudrions prendre comme fil conducteur, non pas tant Pablo Picasso – qui a si assidûment fréquenté dans les années 1900-1920 le célèbre cirque parisien Medrano, installé sur le boulevard de Rochechouart, qui a représenté arlequins [Arlequin, 1917, Musée Picasso, Barcelone ; Portrait d’adolescent en Pierrot, 1922, Musée Picasso, Paris ; Paul en Arlequin, 1924, Musée Picasso, Paris], acrobates [Famille d’acrobates et singe, 1905, Göteborg Konstmuseum ; L’Acrobate, 1930, Musée Picasso, Paris], jongleurs, écuyère (on soulignera l’importance du rideau de scène qu’il réalise, en 1917, pour le ballet Parade d’Erik Satie, donné par les Ballets russes de Diaghilev au Théâtre du Châtelet [Rideau de scène pour le ballet Parade, 1917, musée national d’Art moderne, centre Pompidou, Paris] –, mais le peintre américain Edward Hopper (1882-1967), avec ce tableau, Soir bleu (1914) [Whitney Museum of American Art, New York], souvenir nostalgique de ses séjours parisiens, et dont la figure centrale, frontale, est celle du clown blanc. Figure qui nous paraît faire passerelle entre les modernités picturales des débuts du XXe siècle et les représentations corrosives, ludiques, ironiques ou désabusées, voire en prenant un contre-pied grotesque de certains artistes contemporains : Cindy Sherman1, Bruce Nauman2, Ugo Rondinone3, et peut-être, la plus proche de la figure-paysage blanche de Hopper, l’artiste américaine Roni Horn avec sa série dessinée et photographique Cabinet of (2001) [Hauser & Wirth Gallery, New York-Londres-Zürich].
Dans une sorte de généalogie commune, nous pourrions, d’ailleurs, débuter ce cheminement visuel en rappelant le portrait en pied, au premier plan, du Gilles dans le tableau de Jean-Antoine Watteau, Pierrot, dit autrefois Gilles (vers 1718-1719) [Musée du Louvre, Paris], ce personnage venu de la commedia dell’arte et qui devient cette figure figée et mélancolique, à part de la vie et de la société. Ce Gilles de Watteau fut l’une des sources du clown triste, immobile de Hopper. Le peintre américain qui effectua plusieurs séjours à Paris entre 1906 et 1907, vécut au rythme de la vie parisienne de l’époque. Il va au théâtre, fréquente les lieux populaires, esquisse des portraits de cette société. Il a assimilé la leçon de Courbet dans son réalisme pictural et celle de Degas dans le choix de son motif : cette vie parisienne qui fascine, faite de fêtes, de bohème, de nouveautés, de distractions, de personnages de la vie moderne. Dans ce panorama des plaisirs, il y a le cirque que les artistes, les écrivains, les poètes ne boudent pas. Dans Soir bleu, qu’il peint en 1914, de retour aux États-Unis, Hopper déroule cette société parisienne dans un trait oscillant entre réalisme et symbolisme. L’artiste est là, le militaire, la prostituée, le maquereau, un couple de bourgeois légèrement effrayé par ces mondes qui se trouvent réunis dans le café.
Et, puis il y a le clown. Clown blanc, clown triste, « autoportrait travesti » de l’artiste, cet artiste dont le statut – comme le souligne Jean Clair dans son texte Parade et palingénésie. Du Cirque chez Picasso et quelques autres pour le catalogue de l’exposition « La Grande Parade » – s’est métamorphosé au siècle de la modernité baudelairienne. L’artiste ne dialogue plus avec les puissants, les souverains, les prélats qui lui passent commande ; il est à l’atelier, il a quitté la peinture ou le portrait d’histoire, il se peint lui et se voit sous les traits de ce clown qu’il rencontre dans les lieux de distraction qu’offrent la société moderne du XIXe siècle. Hopper s’inscrit dans cette « tradition issue de Baudelaire, de Toulouse-Lautrec ou de Georges Rouault » et identifie l’artiste « aux marginaux, saltimbanques et autres prostituées » (in Didier Ottinger, Le réalisme transcendantal d’Edward Hopper, catalogue de l’exposition Hopper, Réunion des musées nationaux, Paris, 2012).
Le cirque est donc bien un « espace » de la vie moderne. Les artistes, poètes et romanciers se l’approprient, avec les formes et les langages corporels que ce dernier libère, déploie et démasque. Ils s’en approprient les protagonistes, ceux de la piste et ceux des gradins. Ceux des marges mais aussi ce public anonyme qui apparaît alors comme un nouveau « motif » – le spectateur moderne –, cette foule démocratique qui émerge, au cœur d’une société du divertissement naissante.
Les noces fructueuses entre les formes circassiennes et l’art moderne
Dès les débuts du cirque, notamment en France où les premiers établissements provisoires dédiés au jeux équestres et aux virtuosités des jongleurs, voltigeurs et acrobates, s’ouvrent (au 16 rue du Faubourg-du-Temple avec, le 5 juillet 1782, le Manège Anglais, remplacé le 16 octobre 1783 par l’Amphithéâtre Anglois des Sieurs Astley père et fils), puis en avril 1807 (avec le Théâtre Cirque Olympique de Franconi de la rue du Mont-Thabor), une concomitance peut se faire entre l’apparition et l’essor de ces nouveaux lieux et formes de spectacle et une sensibilité romantique qui s’épanouit alors.
Cette concomitance s’affirme sous le Second Empire. La seconde moitié du XIXe siècle voit la construction d’un certain nombre de bâtiments pérennes : le cirque d’Été (appelé Cirque de l’Impératrice jusqu’à la chute de l’Empire) sur les Champs-Élysées en 1841, le cirque d’Hiver (nommé à l’origine Cirque Napoléon) en décembre 1852, sur le boulevard des Filles-du-Calvaire, ou encore le cirque Molier (cirque amateur), en 1880, rue de Benouville, et plus tardivement le Nouveau Cirque, rue Saint-Honoré, en février 1886. Le cirque, dans ces premières décennies du XIXe siècle s’installe, se singularise. Ainsi en 1868, avec son Clown au cirque [Musée Kröller-Müller, Otterlo, Pays-Bas] Pierre-Auguste Renoir s’empare de ce personnage que nous avons pris comme fil conducteur. Il est au centre de cette piste du cirque au même niveau de regard que les spectateurs, ce public nouveau, que le peintre représente également. Nous pourrions dire que le tableau et le motif sont « plantés ». En 1901-1902, Renoir représentera un Pierrot blanc [Detroit Institut of Arts, Détroit] dans son costume blanc, en pied, occupant tout l’espace de la toile. On peut y repérer toute la constitution du motif et de la représentation impressionniste de ce personnage désormais familier. Entre-temps, le cirque est bien devenu l’un des thèmes privilégiés des artistes. En 1879, Renoir représente ses Acrobates au cirque Fernando (Francisca et Angelina Wartenberg) [Art Institut of Chicago, Chicago]. Le cirque Fernando, construit en 1875 sur le boulevard de Rochechouart, accueille ce nouveau public de bourgeois, d’artistes et de classes populaires. Toulouse-Lautrec en sera un fidèle, fasciné par les numéros des clowns, des acrobates, des écuyères. Il y puisera de nouvelles sources de personnages, d’attitudes, de travail du trait et de la couleur : Au cirque Fernando : écuyère (1887-1888) [Art Institut of Chicago, Chicago]. Mais, Toulouse-Lautrec sera aussi hanté par le clown, et la clownesse : La Clownesse Cha-U-Kao (1895) [Musée d’Orsay, Paris]. Personnage plus singulier, magnifique de crudité et de solitude, magnifique de désespoir, qui se rapproche des figures croisées au Moulin-Rouge.
En 1897, le cirque Fernando deviendra le cirque Medrano. Un lieu mythique est né, « véritable royaume de l’art moderne ». L’art et le cirque s’ouvrent à des noces fructueuses. Des noces qui unissent l’avant-garde et le divertissement de la vie moderne – avec, en arrière-plan, toujours, la présence de ce monde des marges, du travestissement, des infinis possibles, de l’incroyable, de l’illusion et du drame. Le cirque et sa piste deviennent paysages de la modernité artistique, ils se déclinent dans les expérimentations formelles du pointillisme, du divisionnisme, du post-impressionnisme, des nabis, du cubisme, du fauvisme… C’est Edgar Degas (Miss La La au cirque Fernando, 1879 [National Gallery, Londres]), Georges Seurat avec Le Cirque, 1891 [Musée d’Orsay, Paris] et sa virevoltante écuyère, Pierre Bonnard et sa Parade (ou la Foire), 1892, [collection particulière], Fernand Léger qui explorera et travaillera ce thème continûment jusqu’à la fin de sa vie en 1955 (Le Cirque Medrano, 1918 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris] ; Les Acrobates en gris, 1942-44 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris] ; L’Acrobate et sa partenaire, 1948 [Tate Britain, Londres] ; La Grande Parade, 1954 [The Salomon R. Guggenheim Museum, New York]), Pablo Picasso (dans l’œuvre duquel nous avons déjà souligné l’importance de ce thème). C’est aussi Georges Rouault et un univers christique du cirque comme métaphore de la souffrance de la condition humaine (Cirque (La Parade), 1905 [musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Paris] ; Pierrot sur fond vert et rose, 1932 [musée national d’art moderne, centre Georges Pompidou, Paris] ; Songe creux, 1946 [musée national d’art moderne, centre Georges Pompidou, Paris]), Marc Chagall dont les figures circassiennes entrent en symbiose avec l’imaginaire intime et les préoccupations politiques de l’artiste [L’Acrobate, 1930 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris] ; Le Cirque bleu, 1950 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris] ; Le Cirque sur fond noir, 1967 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris], Alexander Calder qui, durant ses années parisiennes, de 1926 à 1933, fréquente avec constance le cirque Medrano et réalise ses fines sculptures en fil métallique et, surtout, son étonnant cirque miniature mobile (Cirque Calder, 1926-1931 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris]), Raoul Dufy (Acrobates sur un cheval de cirque, 1934 [musée national d’Art moderne, centre Georges Pompidou, Paris], et surtout Jean Dufy, son frère, grand amateur et connaisseur du cirque, qui produit et accumule des années 1920 aux années 1950 nombre de tableaux et d’aquarelles restituant la fantaisie colorée, rêveuse, de l’espace circassien (Le Cirque, 1927 [collection particulière] ; L’Écuyère, 1928 [collection particulière] ; La Fil-de-fériste à l’ombrelle, 1937-1939 [collection particulière] ; Clowns musiciens, thème récurrent, jusqu’en 1958 [collection particulière])…
Retour ambivalent de la figure du clown dans l’art contemporain
Modernité, ou modernités au pluriel pour résumer les plasticités multiples que le motif circassien connaît et permet durant toute cette période. Le clown blanc d’Edward Hopper dans lequel l’artiste s’identifie, se dissout dans les tragédies du siècle. Le cirque quitte la scène artistique dans les années 1960-1970… Moment contemporain… C’est par la figure du clown encore, que certains artistes d’aujourd’hui – par une autre filiation que Didier Ottinger, dans son article Le Cirque de la cruauté. Portrait du clown contemporain en Sisyphe (in le catalogue de La Grande Parade, ibidem, p. 35), rappelle, celle non plus des Gilles et des pierrots tristes, mais celle des « Hanlon-Lee, six frères d’origine irlandaise qui, à coup de gifles sonores, de galipettes erratiques, ont révolutionné l’art clownesque, rendant obsolète, presque instantanément, la pantomime et son art du silence » – retrouvent la figure du cirque. Et parce que, encore une fois, cette figure, dans sa polysémie, permet de questionner les identités, les stéréotypes, ce « clown contemporain » que mettent en scène des artistes américains comme Bruce Nauman (Torture de clowns (nuit sombre et venteuse avec rire), 1987 [collection Barbara Balkin Cottle et Robert Cottle]) ou Paul McCarthy (Peintre, 1995 [musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa] dans leurs photographies, vidéos ou installations, performances de la fin des années 1960 et des années 1970-1980, leur sert de vecteur de contestation du modèle moderniste dans son format conceptuel et minimaliste, tel qu’il s’impose sur la scène artistique. Vecteur aussi encore une fois d’un « renversement des valeurs ». C’est un réalisme expressif qui joue du grotesque, de la sexualité exhibée, de la société du spectacle et de consommation de masse. Interrogation des identités que l’on retrouve chez Cindy Sherman, lorsqu’elle réalise, entre autres, au début des années 2000, une série photographique (Sans titre n°411, 2003 [Metro Picture, New York]) où, travaillant toujours l’image de soi et le travestissement, elle s’auto-portraiture en clown. Un clown qui, sous son lourd masque surchargé de couleurs et grimaçant, porte la tristesse et la mélancolie de celui de Soir bleu. Ce paysage des identités mouvantes et androgynes se déploie avec les séries Cabinet of et Clowndoubt (2001) de l’artiste Roni Horn. Portraits photographiques découpés puis recomposés, rendant l’image, certes floue, certes apparemment illisible, mais parfaitement sensible aux variations d’expressivité. Le doute, le trouble sont le contemporain. Du Gilles de Watteau au clown triste de Hopper, à celui grotesque de Nauman, Horn prélève et défait pour recomposer un paysage ambivalent.
Les relations des formes circassiennes avec les formes plastiques se placent sans doute toujours sur ce mode des renversements et des expériences à la fois formelles et sensibles. Aujourd’hui, l’art contemporain est de plus en plus engagé dans les formes de la performance. Ou de nouveaux protocoles de la performance, après le moment historique des années 1960-1970. Sans doute, l’écriture à venir d’une autre histoire de concomitances…
L’art de la ligne
par Pascal Jacob
En Occident, la période romane révèle avec acuité l'appropriation symbolique du corps de l’acrobate, largement figurée dans la statuaire sacrée. Sculpté sur de nombreux modillons, il symbolise l'étape ultime de la spiritualisation, buste et visage tournés vers le ciel.
L’une des plus célèbres représentations est celle de l’église d’Aulnay en Charente-Maritime, où la nudité de l’acrobate stigmatise sa fragilité et renforce l’impression d’effort à produire pour acquérir une pureté intérieure propre à accomplir son retournement, c’est-à-dire son passage de l’état de païen à celui de chrétien. À Loizé, une petite commune des Deux-Sèvres, le portail de l’église abrite un bel acrobate soutenu, protégé par un partenaire barbu, la représentation d’un sage à l’évidence, mais aussi une troublante évocation du geste séculaire qui consiste à parer la chute éventuelle…
Symboles de progrès, de renaissance et de transition ou figures paradoxalement suggestives à caractère démoniaque, ces silhouettes façonnées dans la pierre, le tuffeau, le marbre ou le calcaire, disent bien la fascination éprouvée par le commun des mortels pour tout ce qui relève de l’étrange et du surnaturel. Cette souplesse liée à la figure du renversement hante toutes les périodes de l’art et reflète cette propension à mêler corps et âme dans une représentation symbolique de la distorsion ou de l’élévation mystique.
Art funéraire
Les fosses de Xi’an, un étrange domaine préservé au cœur de la Chine où s’étire depuis le IIIe siècle avant notre ère une immense armée façonnée par des centaines de sculpteurs scrupuleux qui ont réussi à donner aux silhouettes des soldats autant d’imperceptibles détails qui permettent de les différencier et de leur insuffler un extraordinaire soupçon de vie, ont révélé récemment à l’occasion de nouvelles fouilles, aux côtés des fantassins et des cavaliers, la présence d’un petit peuple d’acrobates, de danseuses et de musiciens. Ces corps sculptés, saisis dans l’accomplissement d’un geste ou d’une posture acrobatique, possèdent la même signification que les fragiles statuettes de terre cuite ensevelies dans les tombeaux des Han. Destinées à se substituer aux cadavres des membres de l’entourage du défunt, traditionnellement immolés en son hommage, ces silhouettes délicatement façonnées incarnent les plaisirs de l’existence et accompagnent symboliquement le mort dans l’au-delà pour continuer à le servir et à le distraire. Cet effet de substitution, phénoménal progrès dans l’histoire des cultes et des rites, génère en creux une extraordinaire floraison d’œuvres d’art. Pièces funéraires, ces objets vont progressivement acquérir un statut artistique et s’imposer comme les reflets plastiques de temps successifs. Contorsionnistes étrusques ou égyptiens, acrobates romains ou chinois, ces silhouettes finement ciselées ou à peine esquissées, sont les premiers repères pour une histoire de la représentation acrobatique. Une aventure artistique intense, teintée d’un soupçon de magie et de beaucoup de force.
Au-delà des lignes
Lorsque Pablo Picasso (1881-1973) et Henri Matisse (1869-1954), synthétisent à leur tour la puissance et la sinuosité du corps acrobatique en une ligne, ils traduisent avec simplicité, au-delà de la pureté du trait, cette inscription du geste et de la distorsion dans l’espace de la représentation. Sobrement posés sur un fond neutre, leurs acrobates remplissent la surface de la toile, se heurtent presque à ses limites et disent en une longue courbe maîtrisée à quel point la souplesse physique s’accorde à la recherche plastique. L’acrobatie est le ciment du cirque et sa pratique s’accorde à celle du dessin pour le peintre ou le sculpteur. Langage, chaque geste, chaque posture s’apparente à un fragment d’alphabet, indispensable à l’écriture d’une phrase ou d’une séquence.
Picasso et Matisse ont décliné sans relâche cette manipulation fabuleuse, mystique, du corps de l’acrobate, jusqu’à l’épure, jusqu’à la ligne qui s’étire sans fin, entre trace et mémoire vive de tous les élans, de toutes les figures qui imprègnent l’histoire d’une discipline transcendée à l’aune d’une pratique millénaire en une forme d’art intuitive empreinte de références au sacré. Si les traces les plus anciennes relèvent de la paléontologie, plusieurs cultures antiques ont valorisé renversement et distorsion pour illustrer renaissance et transition, passage et transfiguration, glissement des ténèbres vers la lumière. Le corps est ici image et vecteur : il permet surtout de signifier avec efficacité la dualité nécessaire entre le monde des morts et celui des vivants.
Les acrobates de Pablo Picasso sont souvent au repos, saltimbanques affranchis de la pesanteur, tracés d’une main à la fois sûre et admirative, témoins d’une fascination pour un monde en marge qui n’a jamais cessé de traverser une œuvre protéiforme. La figure du bateleur, du funambule, du jongleur et du clown sont questionnées et transcendées par Jean Starobinski dans son Portrait de l’artiste en saltimbanque, Les Odes Funambulesques de Théodore de Banville ou Le Funambule de Jean Genet, contrepoints littéraires et poétiques aux créations plastiques de leurs contemporains.
Filiations
Comme Pablo Picasso et Henri Matisse, Georges Rouault (1871-1958), Raoul Dufy (1877-1953) et son frère Jean (1888-1964), Fernand Léger (1881-1955), Marc Chagall (1887-1985), Otto Dix (1891-1969), André Derain (1880-1954), Marcel Vertès (1895-1961), Kees Van Dongen (1877-1968), Oskar Kokoshka (1886-1980), parmi beaucoup d’autres, ont aimé le cirque, ses trapézistes, ses écuyères et ses clowns. Ils ont tramé leur vocabulaire pictural de corps puissants, inscrits sur le papier ou dans la toile comme autant de repères de mémoire pour traduire un flamboyant répertoire de formes pures, stylisées ou abstraites.
Avant eux, Victor Adam ou Carle Vernet ont apprécié la grâce et l’élégance des écuyers et des écuyères, produisant toiles et illustrations comme autant de miroirs de l’équitation spectaculaire du temps.
Peintre, illustrateur et sculpteur, Gustave Doré (1832-1883) a lui aussi exploré le thème des saltimbanques au travers notamment d’une composition magistrale, L’enfant blessé , esquissée en 1853 et reprise en 1873 et 1874 avec de subtiles variations à l’instar des versions conservées au Musée d’art Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand et au Denver Art Museum. Il y décrit la détresse d’un monde en marge lorsqu’il est confronté au destin le plus sombre, agrémentant sa toile de symboles forts, à l’image des cartes et de la chouette, mais il en fait aussi une œuvre à caractère sacré en suggérant une pieta gitane, jouant sur une architecture de diagonales pour créer à la fois profondeur et dynamisme. En 1870, il peint un autoportrait saisissant où il apparaît en pierrot, un personnage ambivalent qui annonce en une troublante synthèse à la fois l’auguste victimisé et le clown au masque blafard et déroutant.
Un autre regard
Edgar Degas (1834-1917), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) et Jean-Louis Forain (1852-1931), mais également Henri Gabriel Ibels (1867-1936), un nabi de la première heure, Charles Dufresne (1876-1938), Edmond Heuzé (1884-1967), qui a réalisé d’innombrables œuvres sur les Fratellini ou Joseph B. Faverot (1862-1946) – élève du peintre et sculpteur Jean-Léon Gerome –, auteur de l’imposante toile qui ornait le contrôle du Cirque Medrano, ont apprécié la puissance des corps en mouvement sur la piste des cirques parisiens. Ils les ont intégrés dans de nombreuses compositions, constituant ainsi un répertoire visuel très riche pour la compréhension des spectacles du temps. Les burins de Bernard Naudin (1876-1946), d’Edgar Chahine (1874-1945) et d’Auguste Brouet (1872-1941) ont gravé de nombreux acrobates, notamment pour illustrer Le Bachelier de Jules Vallès (1879), les Fêtes Foraines de Gabriel Mourey dans son édition de luxe (1927) ou Les Frères Zemganno d’Edmond de Goncourt (1879).
Le corps de l’acrobate, la puissance des chevaux, la souplesse des fauves exercent une fascination inépuisable sur les artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes ou musiciens. La Boutique Fantasque de Gioacchino Rossini et Parade d’Erik Satie répondent à Lulu de Frank Wedekind et Alban Berg : suite orchestrale ou opéra, ces œuvres impliquent des figures d’acrobates et conjuguent le charme et l’énergie qui peuvent caractériser le dynamisme des équilibristes ou des clowns.
Inventée dans les premières décennies du XIXe siècle, la photographie, littéralement un « dessin avec de la lumière », a accompagné les mutations du temps et contribué à fixer bon nombre de ses inventions les plus notables. Sans se substituer totalement à la peinture, la photographie rend compte néanmoins de la puissance d’évocation des hommes, des paysages et des lieux : le cirque devient très vite un thème d’intérêt à la fois pictural et commercial. La Bibliothèque nationale de France conserve notamment une série de portraits de Jules Léotard, le créateur de la Course aux trapèzes en 1859, un témoignage à la fois plastique et historique qui tient autant du document publicitaire que du geste artistique. Les développements techniques vont permettre de saisir le mouvement, de fixer l’action avec précision et d’offrir ainsi aux photographes un champ d’exploration inépuisable. Dès les premières années du XXe siècle, clowns, acrobates et écuyers, mais aussi chapiteaux, scènes de vie, parades et campements, vont s’incarner dans l’objectif de nombreux photographes, fascinés par le mélange d’étrangeté et de brillance qui singularise cet univers. August Sander (1876-1964) inclut des hommes et des femmes de cirque, artistes et techniciens, dans sa célèbre galerie People of the 20th Century réalisée en 1924, Otto Umbehr (1902-1980), photo-journaliste et plasticien, saisit l’auguste Grock dans une série de saisissants portraits tandis qu’Izis (1911-1980), Pierre Jahan (1909-2003) et Brassaï (1899-1984) s’attachent à la poésie des coulisses, traçant en noir et blanc d’émouvantes lignes de force d’un monde déjà fragilisé par les avancées de la société moderne issue de la Seconde Guerre mondiale. Paul de Cordon, François Tuefferd (1912-1996), Robert Doisneau (1912-1994), Philippe Cibille, Gilles Henri Polge ou Christophe Raynaud de Lage, contemporains, sont les continuateurs et les héritiers d’une école française, tenants d’une photographie humaniste, soucieuse de rendre compte des réalités d’un monde en marche comme d’en poétiser ses instants les plus étonnants.
Instantanés
Aux États-Unis, Frederick Glasier (1866-1950) immortalise la vie quotidienne des grands cirques voyageurs, notamment le Sparks Circus et Ringling Bros. and Barnum & Bailey : il ouvre la voie à une génération de photographes qui vont faire du cirque l’un de leurs thèmes d’intérêt ponctuel ou récurrent. Jill Freedman (1940 -), qui a suivi notamment le Clyde Beatty and Cole Bros. Circus et son troupeau d’éléphants, prétextes à de magnifiques images, Paul Strand (1890-1976), Robert Frank (1924-), Bruce Davidson (1933-) ou Diane Arbus (1923-1971) s’intéressent à une communauté en marge de l’American way of life et en brossent de magnifiques portraits auxquels l’utilisation du noir et blanc confère une beauté singulière.
Dans ses séries bâties autour des peuples de l’Inde et du Mexique, Mary Ellen Mark (1940-2015) tente notamment de capter la fragilité des jeunes acrobates, qu’il s’agisse de minces équilibristes du Chiapas ou de fragiles contorsionnistes népalaises, attachés à d’immenses caravansérails qui parcourent des territoires lointains où ils réinventent chaque jour des gestes millénaires pour un public captivé. Mais elle s’attache aussi à rendre compte des rapports qui unissent les bêtes et leurs dresseurs, photographiant singes, éléphants et hippopotames devenus partenaires exemplaires d’une communauté improbable. Le noir et blanc s’accorde bien à ces jeux d’ombres et de lumière pour fixer un répertoire immatériel fondé sur des pratiques universelles : les photographies de Sarah Moon (1939-) suggèrent d’autres histoires, d’autres rencontres, mais les sources, de Paris à Saint-Pétersbourg, sont les mêmes. Ben Hopper fait œuvre à partir du corps des acrobates, inscrits sur un fond neutre, la peau enduite de terre, de craie ou de pollen, saisissants d’intensité. À l’instar des Mandragores, contorsionnistes photographiées par Patrice Bouvier, ses acrobates sont imprégnés par une identique propension à se fondre dans le creuset symbolique de la dislocation visuelle. Le corps du contorsionniste nu photographié par Albert Londe (1858-1917) autour de 1900 s’insère dans une comptabilité similaire, un recensement sensible et évocateur de la détermination du corps humain à faire oublier son apparente rigidité. Le peintre Jules Garnier sollicita le même Albert Londe pour une série d’instantanés photographiques à partir desquels il réalisa quelques planches pour l’ouvrage d’Hugues Le Roux, Les Jeux du cirque et la vie foraine. Le photographe dressa ses appareils, plus de 50 pour l’occasion, pour être à même de capturer « des positions intermédiaires que l’œil ne peut saisir » et ne sélectionna que 7 plaques sur les 600 produites…Corps extrême
Chez Beckmann ou Louise Bourgeois, la distorsion du corps est parfois poussée jusqu’à la représentation de l’arc d’hystérie défini par le professeur Charcot : illustration gestuelle du déséquilibre par excellence, la cambrure dorsale est considérée en psychiatrie comme la contrepartie symbolique de la mélancolie : Alfred Kubin (1877-1959), Max Klinger (1857-1920) ou Auguste Rodin (1840-1917) ont eux aussi décliné avec force, ironie et précision cette posture classique du « pont », incarnation spectaculaire de la figure du renversement et trait d’union graphique et sensuel entre métaphore et réalité dans l’accomplissement de la prouesse. À ce jeu élégant de la métaphore, des artistes comme Félicien Rops (1833-1898) ou Gus Bofa (1883-1968) vont rivaliser de virtuosité graphique pour intégrer à leurs compositions subversives ou décalées des acrobates aux corps souples et évocateurs.
L’espace dévolu aux arts décoratifs entre les deux guerres offre des possibilités infinies d’intégration de formes esthétiques très différentes, inspirées notamment par le spectacle vivant et d’une formidable exubérance. L’Art déco triomphant à partir de 1925 ancre ses thèmes d’inspiration dans un répertoire visuel riche et dynamique où l’acrobate occupe une place étonnante. C’est le cas, par exemple, pour le sculpteur d’origine roumaine Demeter Chiparus (1886-1947) qui crée d’élégantes figurines où le bronze polychrome se mêle à l’ivoire. Les statuettes chryséléphantines empruntent autant à la mythologie et à l’Antiquité qu’au sport ou à l’acrobatie : un petit peuple de jongleuses, d’équilibristes, de dompteurs, d’écuyers, de clowns et d’acrobates envahit les intérieurs bourgeois, s’installe sur crédences et guéridons et fait cohabiter l’imaginaire du cirque avec les différents moments de la vie quotidienne. Sculptés sur des linteaux d’armoire, enroulés dans des médaillons de marbre, à l’image de certains éléments décoratifs du métro de Moscou, silhouettes et personnages du cirque enrichissent aussi le répertoire des objets usuels et deviennent de charmants supports de lampes, à l’instar de celles de la marque Berger, comme d’élégants ornements pour des pièces de faïence ou de céramique produites notamment par les faïenceries de Choisy, Gien ou Creil et Montereau.
Aujourd’hui encore, les artistes continuent d’interroger la figure de l’acrobate à l’instar du sculpteur Philippe Arnault ou de la jeune plasticienne Manon Paquet qui peint d’immenses silhouettes colorées, fragmentées et assemblées par des épingles sur de larges surfaces blanches. Des parois de la caverne à la simplicité de la cimaise, la fascination est intacte.
1. Cindy Sherman, série des Clowns, 2003-2004.
2. Bruce Nauman, Clown Torture, 1987.
3. Ugo Rondinone, série If There were Anywhere but Desert, 2002.