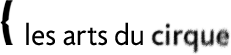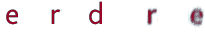par Pascal Jacob
Axe majeur de définition d’un certain type de cirque, le dressage et la présentation des animaux sauvages ont contribué dès la fin du XIXe siècle à faire de nombreux spectacles européens, américains ou australiens un panégyrique de l’exotisme et un miroir de la colonisation. La fascination pour un ailleurs lointain a longtemps servi de carburant pour l’exploitation d’entreprises lancées dans une course frénétique à l’exploit. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, des dizaines de milliers d’animaux sauvages ont contribué à bâtir une immense fresque tour à tour docile et rugissante, mais la prise de conscience des sociétés occidentales au début des années 1970, associée au développement des lois pour la protection de la faune, a singulièrement fragilisé un univers encore un peu plus ancré à la marge des autres formes de divertissement.
La curiosité a mué, le regard et la perception du public ont évolué et si l’animal vivant continue de provoquer l’étonnement, désormais il mobilise également un faisceau d’émotions contradictoires quant à sa condition et son statut sur une piste ou une scène. À partir des années 1970, le principe de dressage s’efface progressivement, à la fois au profit d’une simple présence d’une créature sauvage, comme un indice de nature et une réponse à un désir d’imaginaire fort, mais aussi en créant des silhouettes de substitution, stylisées ou hyperréalistes.
La notion d’évocation est déterminante pour comprendre les effets d’une mutation amorcée à la fin des années 1990. La créativité des compagnies est inépuisable et les œuvres qui citent ou font la part belle à des animaux interprétés se multiplient. Les chasseurs de Girafes de la compagnie Royal de Luxe en 2000 transgressent la norme en invitant dans l’espace public de véritables sculptures « vivantes », surdimensionnées et animées par des manipulateurs bien visibles, dans l’esprit d’un bunraku revisité. En 2003, le Sugar Beast Circus, « cirque indisciplinaire » selon sa fondatrice Geneva Foster Gluck, s’amuse des codes d’un cirque pétri de conventions en utilisant notamment des masques de lions surdimensionnés pour développer des séquences pleines d’humour en contrepoint d’images puissantes. Une forme de fantaisie que le Théâtre de la Licorne intègre avec Le Bestiaire forain en 2002 ou Les Encombrants font leur Cirque mis en scène par Claire Dancoisne en 2012. Le rhinocéros conçu pour ce spectacle est une formidable silhouette animée, énorme et mobile, à la fois touchante et impressionnante, mais aussi très efficace pour ancrer le spectacle à l’univers du cirque et de l’exhibition.
Vers l’abstraction
Façonnés dans du caoutchouc de récupération importé du Kenya, les animaux de Cirkafrika, spectacle du Cirque Phénix créé par Alain M. Pacherie, sont réalisés artisanalement dans un petit atelier de Dar es Salaam en Tanzanie. Les bêtes sont inspirées par les créatures emblématiques de la savane africaine, oscillant d’une pièce à l’autre entre réalisme et stylisation, mêlant fibres végétales, peinture et caoutchouc pour réaliser une ménagerie décalée, mais dont les pensionnaires sont toujours parfaitement identifiables. Un crocodile et deux éléphants plus vrais que nature, une tortue et une girafe aux teintes franches, mais à l’allure plus ironique que réaliste, une antilope plutôt juste en termes de couleurs et de proportions et deux autres girafes, davantage conçues comme des silhouettes et des supports de danse avec de longues jupes frangées de rafia, complètent un ensemble joyeux et festif. Le défilé de ces bêtes est un écho d’une pratique ancienne où les clowns faisaient la part belle à des partenaires de chiffon peint pour créer des parodies légères avec de faux chevaux ou, dans le cas des Fratellini, une vache aux yeux ravageurs pour une corrida aux accents élisabéthains. Lorsqu’elle « éventrait » le cheval d’un picador, celui-ci abandonnait sur la piste un chapelet de viscères en tissu, un réalisme théâtral similaire à l’étoffe rouge que les comédiens du Globe, de la Rose ou du Swan faisaient subrepticement jaillir de leur pourpoint pour signifier une blessure. Ces animaux factices, réalistes sans excès, sont aussi les ancêtres des personnages créés par Julie Taymor pour l’adaptation scénique du Roi Lion à Broadway. Animés de l’intérieur, ils se dotent ainsi d’une capacité de mouvement inédite, mais appartiennent toujours au registre figuratif. Ils relèvent d’une même fascination pour l’imitation et la ressemblance, le jeu et le décalage avec le vivant, parfois jusqu’à l’osmose entre corps et peau, muscles et carapace, entre l’acteur et la créature qu’il anime.
Le glissement vers une forme d’abstraction dans la représentation d’animaux sauvages est une séduisante mutation qui se produit progressivement. La bête devient métaphorique. Les Oiseaux du Cirque Réinventé, spectacle du Cirque du Soleil où le goût pour l’animalité s’exprime aussi dans un collectif de bascule où les acrobates évoquent des pingouins stylisés, suggèrent un premier décalage. Les caractéristiques essentielles de l’animal sont respectées, mais il apparaît vite évident qu’un simple amoncellement d’étoffes peut se révéler aussi puissant qu’un animal… vivant ! L’éléphant imaginé et conçu par Victoria Chaplin pour Raoul, spectacle de James Thiérrée créé en 2012, relève de cette magie singulière, lorsqu’une forme a priori abstraite prend vie et devient une fenêtre grande ouverte sur l’imaginaire. Cette dissolution du réel est encore plus forte avec un processus d’assemblage d’éléments disparates à l’instar d’un corset de velours associé à deux chandeliers et une large pièce de tissu pour donner apparence et « vie » à un élan aux lignes impeccables et à la justesse confondante. Ce principe de construction à vue, où rien n’est donné à l’avance au spectateur, détermine un autre seuil d’appréhension de l’animalité sur une piste ou un plateau.
Dans un registre similaire mais décalé, la compagnie catalane Animal Religion crée en 2015 Tauromaquina, une corrida acrobatique et chorégraphiée où la bête est incarnée par un chariot élévateur dont les lames figurent bien les cornes acérées du taureau. L’engagement est fort, les roues de l’engin font voler la poussière de l’arène et les rapports de force entre l’homme et la machine sont parfois très au-delà d’une simple évocation au point que l’on finit parfois par y croire…
Le processus de dissolution de l’apparence, l’abolition de signes clairs d’identification d’une quelconque bête réelle, la mise en œuvre d’une forme d’épure suggestive, trouve sa pleine résolution en 2002 avec la parodie de dressage d’une créature suggestive aux allures de monstre de toile, une énorme structure gonflable, d’un parfait gris mat et semblable à une peau d’éléphant, « domptée » par Bruno West sur la piste du Cirque dans les Étoiles. Créature suggestive, La Bête est tour à tour selon les imaginations semblable à un éléphant, de mer ou de terre, un hippopotame ou un rhinocéros, mais aussi, pourquoi pas, une construction de l’esprit, abstraite et figurative tout à la fois. Rien n’identifie un animal précis, mais tous les codes de représentation sont respectés et la masse légère de l’objet, confrontée à la taille du dompteur paré de tous les attributs de la fonction, ne laisse guère planer de doute. Il s’agit bien d’une « bête », imprévue et imprévisible, féroce peut-être, exotique c’est certain.
Mutations
Cette indécision marque également l’improbable bête à deux têtes imaginée pour La Tribu Iota, spectacle de la 12e promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne mis en piste par Francesca Lattuada. Une étrange silhouette qui pourrait appartenir à la fois à un chien ou à un ours, mais qui suscite sans coup férir la surprise… La promotion suivante avec le spectacle Cyrk 13 mis en scène par Philippe Decouflé intègre avec humour une figure contemporaine du dompteur en jouant avec un tigre en peluche porté sur les épaules de Gaël Santisteva comme naguère Claire Héliot ou Eugène Weidman le faisaient avec leurs vrais fauves.
Le Cirque Plume met en scène un autre animal, encore plus indistinct, incarné par un groupe de parapluies rouges, tenu en respect à coups de jet d’eau par un dresseur habile et convaincu. Lorsque cet agrégat rouge sang s’avance sur le plateau de Plic Ploc, le public retient son souffle, à la fois surpris et émerveillé : solitaire, le parapluie est anodin. En groupe, il devient effrayant, capable d’avaler l’imprudent dresseur qui s’en est approché sans précaution. Cet amoncellement d’objets usuels, transcendés par l’imagination du metteur en scène comme par celle du public, est une merveilleuse manière d’effacer le fauve au profit de toutes les bêtes de la Création, rassemblées sans limites ni contours dans une joyeuse construction pleine de fantaisie. Les structures mouvantes inventées par Johann Le Guillerm pour ses créations successives appartiennent au même registre : dotées d’une vie propre par le jeu de subtils assemblages, sans rouages ni mécanisme complexe, elles procèdent d’une troublante organicité. Échappées d’un cabinet de curiosités contemporain, elles sont portées par un souffle créatif exceptionnel qui puise aux mêmes sources que celles de l’exhibition et du détournement.
Cette forme d’abstraction, élaborée et assumée, pourrait signer le déclin définitif de toute autre forme de représentation, mais l’animal a la vie dure et, comme le cirque, il sait se révéler protéiforme : à l’exact opposé des créations de la compagnie de Rasposo ou du cirque Plume, le spectacle de Noël monté au Circo Price de Madrid en 2016 a provoqué une vraie sensation avec un numéro d’ours polaires totalement factices, mais réalisés avec un soin du détail confinant à l’hyperréalisme. Entre innovation provocante et subtil pas de côté, ces animaux plus vrais que nature, capables de créer une illusion durable en étant soigneusement éclairés, sont une amusante façon de perturber des cartes que l’on pensait déjà distribuées. Cet effet de proximité, comme un formidable raccourci entre l’homme et le fauve, l’expression d’une distorsion d’une réalité désormais impossible à assumer plus longtemps. Ultimes pirouettes de l’histoire, le marabout « dressé » de la Volière Dromesko ou l’intégration d’une séquence de dressage avec un « vrai » tigre comme conclusion du spectacle Morsures, stigmatisent ce rapport intuitif et complexe que l’homme entretient avec le vivant depuis la nuit des temps. Avec ce fauve, Marie Molliens renoue les fils du dialogue avec une discipline réfutée ou oubliée par les courants successifs du Nouveau cirque, du cirque contemporain ou l’arborescence acceptée des Arts du cirque. La compagnie Rasposo a régulièrement intégré des animaux vivants dans ses spectacles, mais l’intrusion d’un fauve repousse le curseur sur l’échelle de l’acceptation de manière significative. Avec La Dévorée, Marie Molliens encore, restitue à des lévriers Barzoïs leur part de sauvagerie originelle et instaure une singulière violence dans ses images. Ce jeu avec l’histoire, entre raccourci brutal et allégorie, cet animal l’incarne avec une densité singulière. Un écho bien plus qu’une continuité.