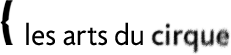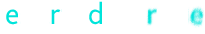par Pascal Jacob
La dénomination de jeux équestres tient à la fois de l’identité et de la confrontation. Matrice de ce qui va devenir le cirque moderne, ces exercices sont marqués par des références à un contexte historique et une théâtralisation naïve. Ils s’appuient sur une trame très simple qui va de la brève saynète à la pantomime équestre, structures narratives très efficaces pour les dissocier de l’exhibition pure.
Le cirque est symboliquement né à cheval et cet animal constitue l’un de ses artifices majeurs depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. En développant une aire de « jeu » circulaire d’un diamètre considéré comme universel à partir de 1779 pour y faire tourner chevaux et cavaliers, le cirque induit l’obligation d’un répertoire aux formes élaborées à partir d’un seul et même support. Le choix du cheval est sans doute conjoncturel : la période est propice à l’acquisition de bêtes délaissées par l’armée et offre à quelques militaires démobilisés une opportunité de capitaliser sur leurs talents de dresseurs et d’écuyers. L’intégration du cheval dans une trame à caractère spectaculaire n’est pas neuve, mais ce que les pionniers du cirque moderne vont concevoir pour et par lui va singulariser une forme dynamique à vocation divertissante.
Les premiers jeux équestres relèvent de la « simple » capacité à se tenir debout sur un cheval lancé au galop : aussi anecdotique que cela puisse paraître, c’est bien là que réside le ferment d’une équitation plus aguicheuse qu’académique, même si très vite le dressage et la haute école contribueront à donner au spectacle de cirque ses premières lettres de noblesse. Philip Astley est probablement meilleur dresseur que voltigeur, mais il paie volontiers de sa personne pour ancrer la représentation dans une perception performante et virtuose en se tenant en équilibre sur sa monture pour susciter applaudissements et oboles. C’est lui aussi qui endosse la défroque d’un tailleur militaire pour créer la première saynète équestre et comique de l’histoire. En 1768, il joue La Course du Tailleur à Brentford, une séquence clownesque inspirée par un fait divers du temps et qui anticipe de la diversité des propositions élaborées à partir du cheval.
Les fresques, les mosaïques et la statuaire antique, mieux appréhendées depuis la redécouverte du monde gréco-romain, le début des missions de fouilles régulières de Pompéi à partir de 1765, la publication de 1751 à 1772 du Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et D’Alembert, les expéditions de Louis-Antoine Bougainville et d’une manière générale le développement d’une immense curiosité pour l’univers et ses mystères sont de constantes sources d’inspiration pour les écuyers et les voltigeurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La Renommée incarnée par Madame Franconi et dessinée par Carle Vernet en 1802 suggère bien la fascination des artistes pour une période de l’histoire riche en références oubliées.
Le Chasseur Indien popularisé par Andrew Ducrow au début du XIXe siècle, repris quelque temps plus tard par Paul (François Laribeau), « le bel écuyer » des Franconi, une saynète incarnée par l’écuyer vêtu d’une tunique légère, le chef orné de plumes multicolores, illustre bien la diversité des « habillages » pour donner un caractère inédit à un enchaînement d’exercices commun à tous les voltigeurs du temps. L’allant, la fougue et l’allure de l’écuyer contribuent largement à singulariser la performance, reproduite ailleurs sous d’autres atours.
L’élan impulsé par Astley en Angleterre et en France est déterminant : les jeux équestres deviennent à la mode et génèrent mécaniquement un désir d’amplifier l’offre spectaculaire. Les Franconi, une famille d’origine italienne qui va constituer la première dynastie du cirque français, vont être à l’origine d’un certain nombre de créations et de codifications d’un genre déjà en pleine mutation. Laurent Franconi, formé par Jules Pellier, favorise le développement de l’équitation académique tandis que son épouse, Catherine Cousy-Franconi, incarne d’étonnantes figures mythologiques sur ses chevaux, à peine vêtue d’une toge à l’antique pour présenter La Renommée devant un parterre de spectateurs conquis. Elle est également à l’origine du saut des rubans, une discipline illustrée en 1890 par Georges Seurat dans son ultime tableau, Le Cirque. Elle ouvre la voie aux écuyères, fragiles silhouettes bientôt parées d’une jupe vaporeuse directement empruntée au vestiaire des ballerines à partir de 1832. En offrant une sorte de précipité des grands ballets romantiques sur leurs chevaux, elles initient par la même occasion une appétence toute neuve pour une forme de narration légère qui va trouver un second souffle avec la création en 1849 du panneau, une large selle de bois recouverte de cuir et qui s’apparente à une scène miniature. Avec le panneau, conçu par l’américain James Morton, s’esquisse une autre dramaturgie des exercices équestres. La surface élargie et relativement stable offerte par ce nouveau support permet l’écriture de véritables pas de deux équestres, prolongement acrobatique du répertoire chorégraphique.
Quelques années plus tôt, l’écuyer britannique Andrew Ducrow, surnommé le Protée à cheval, crée Le Courrier de Saint-Pétersbourg sur la piste de l’Amphithéâtre Astley, une performance extraordinaire présentée pour la première fois en 1827. La prouesse consiste à se tenir debout en équilibre sur deux chevaux au galop, un pied sur chacun d’eux en s’efforçant de les tenir suffisamment écartés pour permettre à d’autres chevaux de passer sous ce pont improvisé tout en saisissant au passage une rêne soigneusement enroulée sur l’encolure du cheval et qui, déployée, contribue à figurer un attelage de cinq, sept, voire neuf, onze ou quinze chevaux. Chacun des chevaux porte un petit drapeau pour symboliser les différents territoires traversés par le « courrier ». L’exercice connaît un retentissement spectaculaire et se trouve transposé selon les pays et les régimes en Poste Royale, Nationale ou Impériale, mais son ascendant sur le public comme sur les écuyers et les écuyères qui s’en emparent est sans commune mesure avec le reste du répertoire. Laurent Franconi, Paul Laribeau, Paul Cuzent, Paul Lalanne ou même Philippine Tourniaire maîtrisent à leur tour l’extraordinaire performance, reprise régulièrement jusqu’à nos jours par des cavaliers en mal de sensations fortes.
La première moitié du XIXe siècle est aussi le temps des reconstitutions de manœuvres militaires sur la piste : immortalisées par le peintre Victor Adam, elles trouvent un écho singulier dans Le Quadrille des Lanciers du Bengale, scène équestre vigoureuse et colorée déployée sur la piste du cirque Pinder dans les années 1950.
Progressivement, les innovations en matière de présentation s’agrègent les unes aux autres pour forger un ensemble de disciplines purement équestres susceptibles à elles seules de composer un programme complet. À la poésie fragile de l’écuyère à panneau s’associe la sobriété des poses plastiques ou des statues vivantes, un exercice basé sur l’immobilité du cheval et de sa cavalière, soigneusement vêtus ou poudrés de blanc, comme s’épanouit la force brute déployée pour maîtriser La Poste et bientôt, pyramides, élévations et jonglage vont offrir de nouvelles possibilités pour le développement de formes collectives et individuelles. Des troupes comme celles des Cristiani, des Loyal-Repensky, des Sobolewski, des Hanneford, des Caroli, des Richter ou des Gruss vont s’appuyer sur des structures familiales puissantes pour constituer ces fameuses pyramides sur trois, quatre ou cinq chevaux, impressionnants châteaux de cartes humains solidement campés sur le dos de bêtes à l’allure martiale et guidées par un maître écuyer attentif à la régulation de leur pas. Avec une base de quatre chevaux, une dizaine de personnes s’étagent sur les épaules des porteurs et créent un fantastique effet de « paroi » vivante.
Une variation sur le même thème consiste à utiliser une plate-forme attelée à deux ou trois chevaux sur laquelle prennent place les écuyers. Alexis Gruss a revisité dans les années 1980 le Phaéton, une voiture élégante aux lignes pures et qui favorise à la fois une mise en contexte du numéro et de solides appuis pour celles et ceux qui s’agrègent au rythme des chevaux. La troupe de cosaques d’origine russe Ali Bek en a donné une version étonnante agrémentée d’un mât planté au centre de la plate-forme et prétexte à des équilibres inédits soutenus par cette perche de plusieurs mètres de haut.
Ce métissage de disciplines, le mât chinois en l’occurrence, est courant au XIXe siècle : le jonglage à cheval, illustré très tôt par les exercices virtuoses de Pierre Mahyeu ou de Jean-Baptiste Auriol, les prouesses de l’antipodiste à cheval Roméo Capité et plus récemment par les performances de Servat Begbudi et Stephan Gruss, s’inscrit bien dans ces assemblages singuliers où l’animal s’impose définitivement comme un puissant support à toutes les variations.