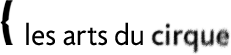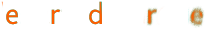par Pascal Jacob
La poussière des planches vaut bien la sciure de la piste pour celles et ceux qui font le choix d’être clown, hier comme aujourd’hui. Comiques de tréteaux, arpenteurs de plateaux, les clowns se jouent du cadre comme d’autres de la gardine. L’aire de jeu n’est pas ronde, mais la cage de scène possède d’autres atouts et s’offre en terrain de jeu atypique pour un personnage historiquement issu du théâtre, mais dont l’identité est associée au cirque depuis 250 ans.
Chemins de traverse
Privilégier la scène permet de s’affranchir d’un certain nombre de contraintes, mais oblige aussi le clown à composer avec quelques paramètres inconnus au cirque. Assimiler la distance, accepter ou contourner le quatrième mur, sont des éléments de vocabulaire aussi forts que la circularité et l’enveloppement, mais la différence essentielle réside sans doute dans un rapport de force inversé.
Lorsqu’il est dans la piste, le clown est dominé par les spectateurs, mais lorsqu’il est sur scène, il possède un étrange ascendant sur son public. Cette possible inversion des rôles et des pouvoirs a sans doute une influence notable sur le choix d’être, ou de ne pas être, un clown de cirque ou de théâtre. Le fait de privilégier l’un ou l’autre de ces territoires n’empêche en rien l’artiste de s’y produire alternativement, mais force est de constater qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle, celles et ceux qui apprécient les planches se risquent finalement peu ou pas sur la piste.
S’affranchir
La possibilité d’être clown sans pour autant travailler sous un chapiteau est une petite révolution qui s’épanouit à l’aube des années 1970. Certes, quelques précurseurs, à l’instar de Grock dans les années 1930, ont déjà fait le choix de bâtir leur carrière dans un circuit de grands théâtres pour lesquels ils adaptent leur jeu, mais dans la foulée des évènements de la décennie 1968-1978 une génération de nouveaux clowns, sans renier pour autant les codes du cirque, s’empare de cet espace à la fois neutre et ouvert et le façonne à sa main. Ces jeunes « héritiers » tracent de puissantes lignes de force qui contribuent à structurer et articuler une pratique aux enjeux multiples. Le corps et le verbe sont des axes fondateurs pour bon nombre d’artistes qui s’appuient sur le premier et délaissent le second. Dimitri Jakob Müller, né à Ascona en 1935, rencontre sa vocation au cirque Knie où il voit pour la première fois un clown, l’aimable Andreff, qui le marque pour le reste de son existence. Depuis ses débuts en 1960 au Schauspielhaus de Zurich, Dimitri fonde son registre comique sur la pratique du mime, mais c’est un registre qu’il enrichit par un travail approfondi sur l’espace et l’accessoire, créant une sorte d’univers parallèle à la frontière du théâtre d’objet. En dépit de quelques incursions sur la piste du cirque Knie entre 1970 et 1979, Dimitri a passé la quasi totalité de sa carrière sur les planches des théâtres du monde, y compris le sien, fondé à Ascona en 1971.
Une destinée artistique proche de celle du Canadien Sol, de son vrai nom Marc Favreau, un clown à l’humour acéré, parfois subversif, mais toujours empreint d’une forme de tendresse pour ses semblables. Marc Favreau crée son personnage à la faveur d’une émission de télévision où il a pour partenaire Louis de Santis, le clown Gobelet. Le duo fera les belles après-midi d’innombrables jeunes auditeurs jusqu’à ce que Sol vive sa vie en solo et entame la conquête d’un autre public d’un bord du monde à l’autre. Clown parleur, Marc Favreau s’appuie sur une silhouette très élaborée de « clochard » et base son comique sur des constructions verbales virtuoses, parfois sous-tendues de réflexions politiques douces amères. Sol marque le temps d’une évolution stylistique très nette et formalise une écriture singulière qui lui permet de revendiquer avec simplicité une identité clownesque inédite. Cette veine théâtrale, brillamment initiée notamment par Dario Fo et Franca Rame, tend à abolir des frontières longtemps considérées comme infranchissables entre clowns et comédiens. À partir de textes puissants, très impliqués politiquement, le jeu clownesque s’immisce sur le plateau avec un mélange de légèreté et d’innocence, mais d’une efficacité redoutable. Cette tension, où les mots sont assemblés au prorata de la violence du réel, est vertigineuse.
Avec leurs pratiques respectives, des figures emblématiques comme celles de Dimitri, Zouc, Sol ou Dario Fo bornent intuitivement un nouveau territoire et préparent le chemin pour toutes celles et ceux qui vont faire le choix d’être clown, notamment au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Transgressifs
Jongleur et magicien, Yann Frisch a commencé par bousculer les règles de jeu et d’esprit, introduisant un soupçon d’humour dans son vertigineux Baltass, préparant sans doute ainsi la voie à son formidable spectacle Le Syndrome de Cassandre où il fait exploser les codes de représentation du jeu clownesque. Il y incarne, au sens le plus strict et le plus profond du terme, un tramp contemporain, violent et déstabilisateur, sans être néanmoins dépourvu d’une certaine tendresse. Clown d’une force peu commune, féroce parfois jusqu’au malaise pour des spectateurs peu préparés à un tel choc, Yann Frisch écartèle la perception d’un personnage longtemps cantonné à la candeur et l’innocence. Cette vision abrupte du jeu clownesque est un chemin que Jango Edwards a déjà largement balisé avec une énergie dévastatrice et un sens aigu du déminage systématique des situations les mieux installées. En érigeant l’insolence et l’outrance en règles d’un jeu de rôles où le public tient sa partie, Jango Edwards fracasse avec délectation les codes de la bienséance scénique. Il crache, éructe, se met à nu, métaphoriquement et littéralement, finissant sa performance au milieu d’un plateau saccagé. Il est à la fois l’incarnation démultipliée de l’histrion, du farceur et du clown shakespearien, une synthèse détonante qui puise son inspiration dans la truculence de ses ancêtres. Jango Edwards fabrique son clown à grands traits, une esquisse sauvage qu’il affine et détaille au feu du plateau. Toujours prêt à improviser, il œuvre dans la matière vive de son canevas, façonnant un comique plus organique que raisonné, toujours à la lisière des réactions de la salle. Cette énergie ne laisse guère de place aux hésitations et chaque représentation est un peu comme un train lancé dans la nuit, avec une destination espérée, mais des péripéties incertaines !
En travaillant ainsi sur un fil aussi ténu qu’il est tendu, Jango Edwards s’appuie sur un métier très sûr pour revisiter des codes de jeu empruntés aux comédiens italiens du XVIe siècle. Il fait basculer la perception du spectateur vers l’intranquillité, un principe d’immersion qui inquiète plus qu’il n’amuse, mais qui rééquilibre les forces dans des salles transformées en creuset bouillonnant où rien ni personne n’est à l’abri de la férocité du clown. C’est une dimension effleurée par Carlo et Alberto Colombaïoni dans les années 1970 et revisitée aujourd’hui par Cédric Paga sous les traits, inquiétants parfois, de Ludor Citrik.
Contestataires
Le clown est d’ailleurs peut-être la discipline contemporaine où s’épanouit le mieux une forme de sauvagerie de l’imagination. Aujourd’hui, écorchées, brutales, poétiques, violentes, tendres ou abruptes, les figures du clown incarnent à la fois un contrepoint puissant et une preuve de résistance face à une certaine déshumanisation du monde. C’est un rôle complexe à endosser tant la défiance vis-à-vis d’un jeu clownesque susceptible de pactiser de manière trop évidente avec le mal et la noirceur du temps est toujours vive. Pourtant, en dépit de cette inquiétude, de nombreux clowns portent un regard incisif sur nos petits et grands travers et développent une perception au scalpel des vicissitudes de nos sociétés. Handicap, intolérance, déplacements humains, violences urbaines et tensions en tous genres sont vécus désormais comme autant de matériaux vifs pour nourrir des écritures saturées d’un vibrant mélange de colère et d’amour. Le clown esquisse un portrait fracassant du monde tout en cultivant l’idée d’un exorcisme de ses peurs par leur représentation décalée. Noircir, c’est aussi suggérer une accalmie, peindre par le rire une lueur d’espoir, un autre possible pour transpercer les ténèbres.
C’est un mode d’approche multiforme qui traverse tout le XXe siècle et permet à des artistes très différents de conjuguer l’ironie au sens. Raymond Souplex et Jane Sourza, comédiens rompus à toutes les facettes du jeu théâtral, revisitent en 1958 la silhouette du tramp américain, entre clochard et vagabond, pour se moquer gentiment d’une campagne de propreté lancée par le général de Gaulle. Une quinzaine d’années plus tard, sous les traits débonnaires de Coluche, le formidable acteur Michel Colucci a porté haut cette forme de dérision, fouaillant largement les certitudes d’une société bien-pensante tout en la confrontant à ses contradictions. Coluche questionne sans relâche les faiblesses humaines, il désosse les peurs communautaires, saupoudre du sel sur les plaies collectives, mais n’oublie jamais d’appliquer un soupçon d’humanité dans la construction de ses personnages. En Afrique du Sud, le satiriste Pieter-Dirk Uys utilise le travestissement et l’humour pour politiser son discours clownesque, marqué par la douleur de l’apartheid. Son personnage de Tannie Evita, toujours accompagnée d’un cactus, est un bouclier à la fois drôle et féroce et s’inscrit depuis les années 1970 dans une filiation humaniste régulièrement incarnée par les clowns.
Figures et caractères
Jos Houben, Ursus et Nadeshkin, les Expirés ou les Zimprobables fondent leur comique sur les mots, mais également sur une mobilité physique remarquable. Issus de formations très différentes, École internationale de théâtre Jacques Lecocq, École Nationale de Cirque de Montréal ou Institut National du Music-Hall du Mans, ils maîtrisent néanmoins respectivement un vocabulaire exceptionnel qui leur permet de construire leurs propre répertoire d’entrées. Cette implication dans la définition d’une identité nourrie par la création marque également le travail du duo Okidok, de Julien Cottereau, de Ludor Citrik, mais également de celui d’Arletti, d’Hélène Ventoura, de Jackie Star, de Gardi Hutter, d’Emma la Clowne, Masha Dimitri ou de Proserpine. Ces personnalités fortes incarnent un clown au féminin, mais décloisonnent aussi un registre longtemps considéré comme essentiellement masculin. Certains, à l’instar de Yann Frisch, clown et magicien, privilégient une légère distorsion du réel, inventent d’étranges rituels et s’amusent de la frontière entre imaginaire et raison qu’ils rendent poreuse pour caractériser autrement le jeu et l’énergie clownesque.
D’autres, comme Goos Meeuwsen ou Anthony et Amélie Venisse, développent des personnages inscrits dans une veine humaniste et s’attachent davantage à la tendresse et l’ironie. Ils construisent de fragiles séquences qui s’emboîtent entre deux performances acrobatiques ou fabriquent des spectacles à l’instar du Concierge écrit et créé par Anthony Venisse, un condensé d’expériences vécues au hasard des tournées où dans tous les théâtres du monde il y a toujours un concierge, une ombre qui a tout vu, tout connu, mais que l’on oublie dès les malles bouclées… Ces personnages qui tiennent un peu parfois du fantôme nourrissent l’imaginaire des clowns et leur offre d’efficaces points d’appui pour élaborer silhouettes et séquences. Ils permettent surtout d’ancrer la fantaisie clownesque dans une réalité contemporaine, tissant de fait de beaux instants complices avec leurs spectateurs. Les Macloma, le trio Les Voilà !, les Licedei, John Gilkey ou Mooky Cornish, jouent de ces tensions joyeuses entre un personnage et un public tout en esquissant tous un comique très personnel.
Résolument hors piste, mais peut-être pas totalement des clowns non plus, des personnages singuliers émergent au cœur d’espaces imprévus à l’image des séries télévisées où le mécanisme classique du duo forgé sur une opposition de caractères fonctionne avec une redoutable efficacité. Les exemples sont nombreux, mais les acteurs qui incarnent le centurion Lucius Vorenus et le légionnaire Titus Pullo dans la série Rome, diffusée entre 2005 et 2007, sont particulièrement justes dans la construction d’un subtil processus du « faire valoir » qui permet de valoriser les palettes respectives de deux excellents comédiens. Avec eux, et beaucoup d’autres, la veine clownesque continue d’être exploitée et de vivre, sinon vibrer, dans de nombreux interstices spectaculaires qu’ils soient virtuels ou bien réels.