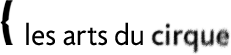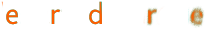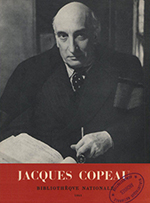Les clowns au théâtre
par Béatrice Picon-Vallin
C’est en 1903, avec Les Acrobates de l’Autrichien Franz von Schönthan (1849-1913) que Vsevolod Meyerhold rencontre pour la première fois le monde du cirque et ses personnages, parmi lesquels un vieux clown qu’il interprète lui-même. Le cirque va représenter un des temps forts de la recherche multi-directionnelle qui animera le grand metteur en scène au tournant de la décennie. Il constitue la base de la galaxie beaucoup plus large du balagan – baraque de foire – un concept de travail, une utopie théâtrale qui synthétise les formes mineures de la culture spectaculaire européenne incarnée par le travail sur des paradistes français, la commedia dell’arte, italienne, les baraques de foire russes, le cabaret, la variété, l’überbrettl allemand, la pantomime, la farce, le cinéma burlesque. Toutes formes considérées comme les réceptacles de la mémoire universelle d’un théâtre théâtral – sujet du livre publié en 1963 par Meyerhold – et comme les forces vitales nécessaires à la reconstruction du théâtre de l’avenir sur les bases solides du grotesque – défini comme un art des contrastes – qui pénètre au cœur même des phénomènes, et dont la scène contemporaine devenue trop livresque a oublié la forme.
« Si on me demandait quels sont les divertissements nécessaires aujourd'hui à notre peuple, quand la Russie apparaît au monde libérée de ses fers, je répondrais sans hésiter : seulement ceux que les gens du cirque sauront donner grâce à leur art. »
Vsevolod Meyerhold, Vive le jongleur (Da zdravstvuet zongler), 1917
Tout se passe comme si les techniques du cirque, où s’est réfugiée la sensibilité carnavalesque, étaient réinvesties par un théâtre d’art moderne à la recherche de son spectateur. Le cirque nourrit trois utopies de la scène meyerholdienne : celle de la corporéité triomphante, celle d’un théâtre de l’improvisation bien préparée et celle d’un public radicalement autre.
En 1913, à Paris où il monte La Pisanelle au Châtelet, Meyerhold fréquente le cirque Medrano en compagnie d’Apollinaire, qui partage aussi avec lui une passion pour la commedia dell’arte. Les clowns sont pour lui une référence privilégiée et sont invités dans l’équipe pédagogique de son Studio (ouvert en 1913 à Saint-Pétersbourg) comme Jacomino, clown italien acrobate et jongleur excentrique, puis Donato, clown-bouffe, spécialiste de gymnastique aérienne. C’est une préparation spécifique pour un acteur nouveau que Meyerhold recherche en ayant recours à ces disciplines. Il se nourrit du cirque sans quitter l’espace du théâtre, pour le régénérer. Meyerhold affirme même en 1924 que c’est seulement dans la pratique des clowns excentriques qu’on trouve « des méthodes authentiquement théâtrales », aptes à nourrir de nouvelles formes scéniques. C’est un célèbre clown russe, Vitali Lazarenko, qui viendra jouer le chef des diables de l’enfer maïakovskien dans sa mise en scène de Mystère-Bouffe en 1921.
Cet intérêt pour les clowns est partagé alors par de nombreux artistes européens : Jean Cocteau, Darius Milhaud, Firmin Gémier, Jacques Copeau se pressent à Medrano pour voir les Fratellini, considérés comme des « comédiens de la piste ». Copeau, comme Meyerhold, invite des clowns à l’École du Vieux-Colombier. Cependant le jeu psychologique y est conservé, et bien loin de la radicalité meyerholdienne, il s’agit non de renouvellement, mais d’un additif nostalgique, malgré son intuition que le clown est un « vrai acteur ».
Les « bouffons du peuple », comme les nomme le poète russe Alexandre Blok, sont donc appelés à intervenir sur scène. Sergueï Radlov à Petrograd crée la Comédie populaire où il engage des clowns. À Prague de 1927 à 1938, les deux clowns-chansonniers Voskovets et Werich se produisent en duo au Théâtre Libéré avec un succès immense.
Dans les années 60, c’est chez Jacques Lecoq qu’Ariane Mnouchkine découvre le travail sur les clowns, avec éblouissement. Elle le transmet à sa troupe. À la recherche d’un théâtre populaire, pour un public populaire, la troupe rêve d’une forme… populaire et s’engage dans une recherche collective expérimentale, sans texte écrit de départ, et qui va durer plus de six mois.
« Au début, on avait l’intention de faire des improvisations en mélangeant tous les personnages : Arlequin, les clowns, on voulait même mettre Bécassine. Peu à peu on s’est aperçu que les clowns étaient tellement forts, ils étaient plus modernes, et ils ont tout mangé. On s’est retrouvés avec un spectacle uniquement avec des clowns. »
Ariane Mnouchkine, Les Clowns, collection Théâtre d’aujourd’hui, émission de L. de Guyencourt, réal. J. Brard, ORTF, 1969, Doc. INA, 2006
Les difficultés sont nombreuses. La première création collective du Théâtre du Soleil est ainsi une difficile création individuelle à plusieurs : sur plus de vingt-cinq acteurs n’émergeront que dix clowns. La seconde difficulté concerne l’engagement physique épuisant réclamé par les personnages que les comédiens engendrent, la troisième les problèmes posés aux femmes-clowns. Les comédiennes vont réussir à composer des créatures explosives qui restent des femmes, à la beauté sauvage et bariolée, et qui, par leur jeu outré, dénoncent le statut des femmes dans une société d’hommes.
Le spectacle fait date. Créé en avril 1969 au Théâtre d’Aubervilliers, puis joué en plein air au Festival d’Avignon et en tournée au Piccolo Teatro de Milan, il sera repris en 1970 à l’Élysée-Montmartre. Les clowns du Soleil questionnent la société et les stéréotypes bourgeois, mais aussi la condition des comédiens eux-mêmes.
Les Clowns ont permis une recherche exigeante et formatrice sur un jeu non réaliste, non psychologique, et le long travail préparatoire a donné aux acteurs de la précision, de la rigueur. Les comédiens ont acquis l’expérience du risque et mieux perçu, à travers eux, le monde de l’enfance. Mais les masques qui avaient tenté une timide percée au Théâtre du Soleil prennent bientôt leur revanche et finissent par chasser les clowns et par triompher dans L’Âge d’or (1975).
On soulignera que le spectacle de 1969 ne présentait pas des clowns de cirque, mais des clowns de théâtre, où les femmes avaient su investir des rôles traditionnellement masculins. C’était, un peu avant l’heure, un spectacle proche de ce qu’on appellera le Nouveau cirque. Un spectacle qui engageait la compagnie sur la voie des grandes créations collectives des années 1970. Les Clowns terminent un cycle au Théâtre du Soleil mais en initient un autre et les petits nez rouges feront des réapparitions périodiques dans le travail théâtral de la troupe, en répétition.
Le clown dans les avant-gardes théâtrales en France
par Krizia Bonaudo
Au début du XXe siècle, les avant-gardes théâtrales avec notamment, Guillaume Apollinaire et André Breton, trouvent avec le cirque et ses personnages un lieu physique et un idéal d’expérimentation formelle et performative. Les pièces puisent dans les thèmes, la performance et la structure langagière du spectacle forain. Le vaste réservoir du cirque renforce le côté spectaculaire du projet des avant-gardes de renouvellement et de défi aux règles académiques, dont le clown, par ses sketches et grimaces, est le profanateur par excellence. Modèle d’artiste complet, acteur et banquiste à la fois, il joue un rôle privilégié de porte-parole d’un message expérimental, de nouvelles techniques expressives et de mise en scène.
Les entrées clownesques fondées sur des culbutes, des chutes comiques et sur des pratiques corporelles, insufflent au spectacle dynamisme, surprise et vitesse, typiques du spectacle forain.
Le corps même du clown change le rapport au public, encouragé à franchir la limite entre scène et salle et à participer activement en suivant les incursions des artistes jonglant et dialoguant avec le parterre. Le parler faux des clowns devient également un modèle langagier pour les avant-gardes qui recourent à des calembours ou puisent dans un vocabulaire forain pour élaborer une esthétique du hors forme et du hors norme.
Guillaume Apollinaire, André Salmon, Le Marchand d’anchois, 1907, Les Mamelles de Tirésias, 1917 ; Tristan Tzara, La Première aventure céleste de Monsieur Antipyrine, 1916 ; Georges Ribemont-Dessaignes, Le Serin muet, 1919 ; Pierre Albert-Birot, Le Bondieu, 1920, L’Homme coupé en morceaux, 1920 ; Marcel Achard, Voulez-vous jouer avec moâ ?, 1920 ; Roger Vitrac, Le Peintre, 1922 ; Le Poison, 1922 ; Louis Aragon, Au pied du mur, 1922/1923 sont autant de pièces fondées sur des entrées clownesques ou sur la présence scénique du clown.
Le clown dans la pédagogie du jeu de l’acteur en France
par Guy Freixe
Jacques Copeau a été l’un des premiers à s’intéresser à l’apport du jeu clownesque dans la pédagogie de l’acteur. En janvier 1916, il découvre avec enthousiasme les Fratellini à Medrano. Il admire leurs lazzi, leur jeu directement en lien avec le public, leur gestuelle rythmée, précise, inventive. Il écrit, enthousiaste, dans son Carnet : « Voilà le vrai acteur1 ! ». Le clown, pour Copeau, relie l’acteur à la vitalité d’une tradition, celle de la commedia dell’arte, fondée sur la spontanéité de l’improvisation, la crédulité de l’enfance et une fantaisie toute corporelle. Copeau engage les Fratellini dans son École du Vieux-Colombier (1921-1924). Mais leur enseignement se limite à l’apprentissage de l’acrobatie. Une pédagogie du jeu par l’art clownesque n’est pas encore née. Pour cela, il faudra attendre l’apport de Jacques Lecoq. Le renouveau du clown de théâtre doit beaucoup à son enseignement. En 1962, six ans après la création de son École à Paris, il commence un travail sur le jeu comique qui s’avèrera déterminant pour le renouveau du clown : un clown qui quittera la piste du cirque où il se meurt pour gagner la rue, les cabarets, les scènes de théâtre. Lecoq a œuvré à cette mutation du clown de cirque vers le clown de théâtre, ouvert à des situations dramatiques renouvelées. Et il a fait du jeu clownesque un territoire dramatique essentiel dans la pédagogie de l’acteur, en l’ouvrant au burlesque et à l’absurde.
La pédagogie du « bide »
En s’interrogeant sur la nature de la relation entre la commedia dell’arte et les clowns de cirque, Lecoq a cherché des exercices pour mieux saisir l’émergence du rire : « J’installais la piste et chacun s’y présentait avec la seule obligation de nous faire rire. C’était terrible, ridicule, personne ne riait ; les élèves-clowns prenaient le "bide" dans l’angoisse générale ; et, à mesure que chacun passait, le même phénomène se renouvelait. Le clown dépité allait s’asseoir, penaud… et c’est à ce moment-là que nous commencions à rire de lui. La pédagogie était trouvée, celle du "bide"2. » Ce n’était pas le personnage que les élèves jouaient qui déclenchait le rire, mais la personne elle-même, mise à nu. Lecoq se rend compte alors de la spécificité du clown, éloigné de tous les autres registres et territoires de jeu où il s’agit au fond de jouer quelqu’un d’autre que soi. Le clown, lui, n’existe pas en dehors de l’acteur qui le joue. Et encore, moins il essaie de "jouer", moins il est volontaire, plus il se laisse surprendre par ses propres fragilités, et plus son clown aura des chances d’apparaître. Car, pour Lecoq, nous sommes tous des clowns, dans le sens où nous voulons tous être beaux, intelligents, forts… alors que nous avons chacun notre « dérisoire3 » qui, en s’exposant, fait rire. Cette découverte de la transformation d’une faiblesse personnelle – physique ou psychique – en force théâtrale fut de la plus grande importance dans la pédagogie de Lecoq. Dès lors, la « recherche de son propre clown » devient une étape essentielle de son enseignement et marque le temps fort de la fin du voyage de l’École. Après l’effacement devant le monde extérieur, dans la recherche sous le masque neutre d’un « fond poétique commun » qui rassemble et unifie, l’élève, à la fin du parcours pédagogique, dans une géométrie inversée, doit être le plus simplement et profondément lui-même, et observer l’effet qu’il produit sur le monde, c’est-à-dire sur le public. Car le clown n’existe qu’à partir du public.
À la recherche de son clown
Pour aider à l’émergence de son clown, Lecoq a recours à un masque, « le plus petit masque du monde » selon son expression, cette boule de couleur qui illumine les yeux et arrondit le visage : le petit nez rouge. Celui-ci opère une mutation. Quand on le met, ce n’est pas seulement un simple objet que l’on pose sur le visage, c’est un événement qui survient. L’intime prend tout à coup une force nouvelle. On se sent plus large, disponible, capable de transformer ses faiblesses en force théâtrale, ses ratages en triomphe. Alors, à force de louper, d’être nul, de multiplier les échecs, à un moment où il ne s’y attend pas, le clown se surprend et nous surprend par sa virtuosité. Car il y a en lui, cachées, enfouies – comme en chacun de nous –, des merveilles, et derrière sa balourdise apparente, des trésors d’adresse insoupçonnés.
C’est sans doute cet appel à l’expression d’un moi profond, secret, unique qui a le plus séduit dans cette formule : « la recherche de son propre clown ». Des stages se sont multipliés, de par le monde, promettant à tout un chacun, comédien ou non, de trouver en quelques semaines, voire quelques jours, « son » clown. Programme holistique de découverte de soi ou simple tactique commerciale ? Il n’est pas toujours facile, en effet, de s’y retrouver dans les propositions de travail sur le clown. Le plus souvent l’objectif est de désinhiber la personne en lui permettant d’exprimer son égotisme dans une fantaisie débridée donnant libre cours à ses pulsions primaires. Le clown rejoint alors sa fonction transgressive originelle, celle d’une bouffonnerie délirante. Il tend d’ailleurs aujourd’hui à quitter le monde du spectacle pour retrouver son autre fonction essentielle, politique, de questionnement de nos sociétés et d’humanisation de nos vies, en multipliant sa présence dans les lieux d’exclusion et d’isolement : hôpital, prison, maison de retraite...
Dans la pédagogie du jeu de l’acteur, Jacques Lecoq a aujourd’hui en France une place reconnue, dans les cours privés ou les conservatoires et écoles nationales d’art dramatique, bien que marginale par rapport à l’interprétation des textes. Le travail sur le clown, souvent proposé sous forme d’immersion d’une ou deux semaines, vise le plus souvent à développer chez l’apprenti-acteur ses capacités d’imagination, une confiance en soi gagnée par le lâcher-prise, le renforcement de la croyance intérieure, la justesse du rythme et l’ouverture au public, car le clown ne joue pas devant lui, mais avec lui. La rencontre avec le travail clownesque est toujours très attendue car celui-ci stimule la créativité et dynamite les cadres habituels du jeu interprétatif. Toutefois, l’expression très individualiste provoquée par le travail clownesque ne doit pas empêcher la rencontre poétique avec une créature attestant du mystère de notre présence au monde. Sans passé ni avenir, dans un pur présent, le clown porte avec lui la croyance totale, irréductible, dans le pouvoir de l’imaginaire. Voilà à quoi initie le clown, dans la perspective de formation d’un acteur-créateur.
1. Jacques Copeau, Cahier « La Comédie improvisée », dans Registres III : Les Registres du Vieux-Colombier I, textes recueillis et établis par Marie-Hélène Dasté et Suzanne Maistre Saint-Denis, Paris, Gallimard, coll. « Pratique du Théâtre », 1979 , p. 321.
2. Jacques Lecoq (dir), Le Théâtre du geste, entretien avec J. Perret, Paris, Bordas, 1987, p. 116.
3. Jacques Lecoq : « La recherche de son propre clown, c’est d’abord la recherche de son propre dérisoire », dans J. Lecoq, J.-G. Carasso et J.-C. Lallias, Le Corps poétique, Arles, Actes Sud-Papiers/ANRAT, 1999, p. 154.