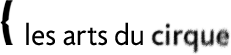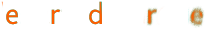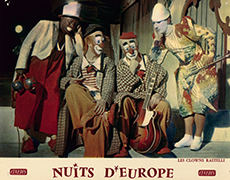par Philippe Goudard
Le développement planétaire de la figure cinématographique du clown est porté par l’envol industriel du cinéma pendant la guerre de 14-18 dans une Amérique du Nord éloignée du terrain des conflits. Cette période et les suivantes, considérablement documentées, sont précédées par un épisode français peu connu de l’histoire des premiers comiques du cinéma.
Le clown dématérialisé
Aux studios Keystone d’Hollywood les futures vedettes comiques mondiales du cinéma burlesque débutent chez Mack Sennett après 1912. Chaplin, Arbuckle, Laurel, Keaton et tous les as de la pantomime anglaise ou de l’acrobatie burlesque transfèrent à l’écran les canevas du vaudeville et de la comédie clownesque. On plante une caméra, on improvise puis on écrit une histoire au montage : c’est ce que retient Chaplin dans ses mémoires. En réalité, enregistrant leurs spectacles, ils perfectionnent l’écriture burlesque et acrobatique par le montage qui donne un autre espace-temps au corps et à l'absurde, tout en contribuant au perfectionnement technique, esthétique et industriel du cinéma. Ils offrent à leur art la pellicule comme nouveau support et les salles de projection comme réseau de diffusion. Ils créent des clowns nouveaux et cinématographiques pour la planète entière. Après les débuts purement burlesques, le clown se replace dans la vraie vie sur-industrialisée par la fiction cinématographique qui lui ouvre les portes du discours et libère son imaginaire. Il gagne une dimension sociale et politique autour de la figure du tramp, incarnée par Chaplin dans L’Émigré en 1917 ou Les Temps modernes en 1936. Comiques du cinéma, du cirque ou du music-hall rivalisent ou passent de l’un à l’autre comme les Marx Brothers, Grock, Iouri Nikouline, Pierre Etaix, Jerry Lewis et aujourd’hui leurs successeurs de toutes cultures.
Le clown sujet de film
Social chez Chaplin, métaphysique chez Keaton, tragique chez Bergman, tendre chez Etaix et même effrayant (It, Tommy Lee Wallace, 1990) le clown devient un personnage de films, de dessins animés, ou de comédies musicales : Be a clown dans The Pirate, (Vincente Minelli, 1948), Phroso dans Freaks (Tod Browning,1931), Frost dans La Nuit des forains (Bergman, 1954), Buttons dans Sous le plus grand chapiteau du Monde (Cecil B.DeMille, 1952).
Il en est aussi le sujet central : Larmes de clown (Sjöström, 1924), The Circus (Chaplin, 1928), Grock (Boese, 1931), I Clown (Fellini, 1971) et nombre de films courts, inaugurent une imposante filmographie d’Eisenstein à Hathaway, Walt Disney, Jacques Tati ou Alex de la Iglesia. Fictions, dont certaines sont documentaires comme The Greatest Show on Earth ou Grock, films d’animation, documentaires, captations, forment un répertoire autant qu’un fonds d’archives, pour l’histoire du clown, du cirque et du cinéma.
Les clowns au cinéma en France avant 1914
par François Amy de la Bretèque
Il faut aborder ce sujet par deux entrées. D’une part, la présence d’acteurs venus du monde de la piste ou plus largement du music-hall est bien attestée et constitue une de ces « séries culturelles » dans lesquelles a puisé le cinéma des premiers temps. D’autre part, des films de la première période – outre ceux qui ont enregistré des numéros, comme l’ont fait Edison, les frères Lumière, Alice Guy et d’autres – ont mis en scène des personnages de clowns, ou perçus comme tels, en tant que héros de fiction. On devine que ces deux volets se chevauchent souvent et que la chaîne des causalités joue dans un sens comme dans l’autre. En outre, la porosité entre les différents milieux des arts du spectacle au tournant des XIXe et XXe siècle oblige l’historien à une grande vigilance.
La présence de gens de cirque à l’écran dès les origines du septième art s’explique par des raisons à la fois institutionnelles et structurelles. Il n’existait évidemment, dans les premières années, aucun corps constitué d’acteurs de cinéma : ils ne feront leur apparition que dans la période d’institutionnalisation, c’est à dire dans les années 1910. Au départ, il faut aller les chercher là où ils se trouvent. On ne recrute pas ou peu d’acteurs de théâtre avant 1908 et les « séries d’Art » pour toute une série de raisons : les bandes sont trop courtes, elles sont privées de parole, et le public visé dans les années 1900 ne fréquente pas ce genre de spectacle. On ira donc tout naturellement vers les viviers du music-hall et du cirque, tous deux fort à la mode à la Belle Époque.
L’école française
Le cinéma muet des premiers temps a exprimé, comme le remarque Jacques Richard dans son Dictionnaire des acteurs du cinéma muet en France (2011) « une verve procédant de clowneries de cirque, qui allait marquer la plupart des séries burlesques de cet avant-guerre ». Il a lui-même mis en évidence la trajectoire de nombre des acteurs burlesques de l’« école française », soit que cette trajectoire commence sur la piste du cirque ou la scène des music-halls, soit que les futures vedettes de l’écran soient passées par les écoles d’acrobatie, comme Raymond Frau au gymnase Saulnier de la Cité Véron. Celui-ci, membre des Ovaro Bros, « excentriques acrobates », où il est le partenaire du clown Gabriel Mansay, commence en 1912 à la Cines italienne sous le nom de Krikri puis en France sous celui de Dandy. Il y montre son « inénarrable dégaine de bourgeois en longue redingote d’auguste », toujours selon Jacques Richard, qui n’est pas sans faire penser au costume à venir d’un certain Charlot.
Sans les passer tous en revue, retenons comme exemplaires quelques-uns des plus connus de ces acteurs burlesques. André Deed, dit Boireau, n’est pas un enfant de la balle, mais il passe par la case du café-concert où il se produit dans une troupe de pantomime acrobatique, celle de John Price, comme son collègue Ernest Bourbon – futur Onésime. C’est dans cette troupe que le réalisateur Jean Durand vient puiser plusieurs des acteurs qu’il engage pour Gaumont et qui deviennent « les Pouites ». Deed appartient aussi aux Omer que filme Alice Guy en 1905-1906. Les troupes françaises de pantomime se calquent sur leurs concurrentes anglaises dont la plus célèbre est celle de Fred Karno d’où sortent Charlie Chaplin et Stan Laurel. Elles anglicisent d’ailleurs leur nom.
Leurs vedettes s’efforcent de se créer un personnage par une silhouette aisément reconnaissable : ainsi, Boireau « en costume blanc ou très clair, gibus en tronc de cône ou melon gris, lourde canne à la main » héritée du slapstick anglais qui donnera son nom au genre burlesque outre-Atlantique. Deed commence au cinéma en 1906 chez Pathé après un passage peu remarqué – mais sans doute important pour lui – chez Georges Méliès. Il devient l’un des plus inspirés des burlesques français. On salue aujourd’hui son inspiration surréaliste avant la lettre dans Les incohérences de Boireau (1912), qui dévoile un monde particulier où l’on tire tout naturellement un poisson dans les arbres au fusil et où l’on pêche un lapin vivant dans la rivière. Soulignons que Deed est déjà une vedette de cinéma internationale. Entre 1909 et 1912 il fait une carrière en Italie sous le nom de Cretinetti avant de revenir en France, et il joue parallèlement sur scène dans plusieurs pays d’Europe. Calino – Clément Migé – est un exemple limite de l’obscurité qui entoure encore l’origine de ces vedettes burlesques. À commencer par sa biographie dont on ne sait pas grand-chose. Jacques Richard suppose qu’il a été formé au cirque mais il le déduit de son agilité et de son aisance avec les fauves, dans Calino dompteur par amour (1912), ou Onésime, Calino et la panthère (1913), tous deux dirigés par Jean Durand chez Gaumont, qui actualisent le motif du dompteur comique. Dans Calino s’endurcit la figure (1912) il reprend un « thème cher aux clowns de piste » : celui du personnage qui sert de punching ball à plusieurs partenaires sans jamais tomber.
Clowns d’écran
On l’a compris : ces acteurs ne sont pas tous des clowns, ils le sont même rarement à part entière. Mais leur formation est polyvalente par nécessité. Le genre naissant dans lequel ils vont s’illustrer les pousse à reprendre et à adapter pour le studio ce qu’ils ont appris sur la scène ou sur la piste. Ils importeront au cinéma certaines situations comiques, voire des entrées en piste telles quelles, comme la planche tournoyante dans Dandy mitron (1920). Ils transposeront et adapteront peu à peu les gestuelles et les mimiques clownesques qui faisaient leur succès, grimaces, larmes, roulements d’yeux…
Le plus souvent, ils créent un personnage qui découle de l’auguste de la scène : extraverti, peureux, souffre-douleur et ils conservent une partie de son accoutrement : veste étriquée, pantalons trop larges, souliers trop grands, l’attirail d’un bourgeois tombé dans la clochardise. Mais pas toujours et avec de multiples variations. Sont-ils pour autant des clowns au sens originel du terme ? Il faut se garder de toute réponse doctrinaire. Les contraintes techniques de la pellicule orthochromatique leur imposent un maquillage assez lourd qui sert aussi à les faire reconnaître, comme les sourcils en accent circonflexe de Boireau. Rien de comparable cependant au lourd maquillage de la piste. À mesure que le cinéma prend conscience de ses ressources propres, ils allègent le côté caricatural de leur personnage. Chacun « lave son faciès de son maquillage de clown », comme l’écrit si justement Jacques Richard à propos de Raymond Frau. Le réalisme inhérent à l’image cinématographique, même dans un univers aussi déconnecté de la réalité que celui des burlesques, impose cette prise en compte. Humaniser leur personnage est une autre affaire. Ce sera l’apport de Max Linder avant Charlot. Mais on peut avancer, au risque de la simplification, qu’ils inventent le « clown d’écran » en le substituant au clown de piste. Et l’on peut se demander si, à long terme, il n’y aura pas un effet de retour sur le jeu et l’apparence des clowns de cirque.
Il faut excepter de cette analyse les tout débuts : Méliès avec Guillaume Tell et le clown (1898), Segundo de Chomon dans le personnage de Une excursion incohérente, se mettent en scène ou représentent des acteurs maquillés en augustes. Emile Cohl dans Mr Clown chez les lilliputiens (1909) et Winsor Mc Kay dans The Rarebit Find (1904), le personnage de Flip dans Little Nemo in Slumberland (film, 1911) font de même dans ce qui sont les premiers dessins animés de l’histoire. On peut en retirer une idée possible : le maquillage du clown émigre dans l’animation…
Le clown personnage de fiction
Il est arrivé que des films de cette période aient choisi d’introduire un personnage de clown dans leur fiction. Ce n’est pas aussi fréquent que plus tard dans l’histoire du cinéma. Il est à noter que l’on ne fit pas appel forcément à des acteurs venus du cirque pour l’interpréter. Voici deux exemples. Dans Le Clown et le pacha neurasthénique (Georges Monca, 1910), un film de l’élitiste SCAGL, on fait appel à Prince (Charles Petitdemange), alias le fameux Rigadin, pour jouer ce rôle de l’amuseur d’un despote déprimé – le film semble perdu aujourd’hui. Or Prince n’est en aucune façon un enfant du cirque : c’est un ancien élève du Conservatoire et ancien acteur des Variétés, comme Max Linder. Il devait donc réaliser ici un rôle de composition. C’est sa performance, son « challenge » dirait-on aujourd’hui, qui faisait l’attraction. La Fille du clown de Georges Denola (1911), autre production SCAGL, embauche Théodore Thalès pour jouer le clown en question. Cet acteur marseillais venait, lui, de la troupe des Pantomimes françaises – il avait interprété entre autres en 1890 Pauvre Pierrot, sujet de la fameuse bande praxinoscopique d’Emile Reynaud. Là, nous sommes dans le drame. Comme personnage de fiction, le clown entre au cinéma par la porte des séries artistiques destinées à un public cultivé, dans la tradition du Roi s’amuse de Hugo (1832), du Rigoletto de Verdi (1850) et du Pagliacci de Leoncavallo, récent succès de l’opéra (1892) quasi contemporain de l’invention du cinéma. Le clown comme personnage de film n’a pas pour vocation de provoquer le rire.
Les clowns du cinéma burlesque américain
par Christian Rolot et Francis Ramirez
Outre-Atlantique aussi, les clowns au cinéma furent fort nombreux. Il y eut bien sûr tous ceux qui d’Europe vinrent y tenter leur chance, quittant pour cela vieux monde, petits chapiteaux, quelquefois même famille, exilés sans bagages prêts pour une autre vie. Parmi eux, Charlie Chaplin et Stan Laurel bien sûr, mais aussi deux futurs imitateurs de Charlot, Billy Ritchie (1879-1921) et Billy Reeves (1866-1945), tous issus de la troupe de mimes anglais de Fred Karno ; le clown irlandais Paddy McGuire (1884-1923), le clown franco-espagnol Marcel Perez (Robinet au cinéma (1911-1914), Clyde Cook (1891-1984), Lupino Lane (1892-1959... Le cinéma burlesque étant alors en plein essor, c’est naturellement là que la plupart se réfugièrent. Quant aux comiques américains « de souche », tous ne venaient pas du cirque, mais beaucoup y puisaient leurs modèles et l’esprit même de leurs personnages. Au sein de cet agrégat quelque peu disparate, se distinguent plusieurs familles : arrive en tête, par ordre d’importance, celle des clowns solitaires.
Le premier auquel on pense est évidemment Charlie Chaplin. Lors de ses débuts en 1914, la force comique de ce petit clown frénétique s’imposa presque immédiatement. Mais bien vite, l’extraordinaire capacité qu’il avait de mêler le rire et les larmes fit de lui bien plus qu’un simple clown. Le mélange des genres n’était toutefois pas sans danger : aussi veilla-t-il soigneusement à ce que le vagabond pathétique ne l’emportât jamais sur l’auguste espiègle qui, par ses facéties, savait si bien retendre la peau des mélodrames.
Harry Langdon (1884-1944) sera quant à lui, et pour une décade seulement, le petit clown charmant, pas encore complètement sorti de l’enfance, malicieux mais sans méchanceté, à qui on se sentait envie de tout pardonner. Entre cet auguste et le public, ce n’était que tendresse partagée.
Dans la catégorie des gros bébés, Roscoe Arbuckle (1887-1933), que tout le monde appelait Fatty, possédait lui aussi un sourire désarmant. C’était pourtant un bébé cruel, dont les partenaires eurent souvent à se méfier. Mime excellent, cascadeur précis, il jouait de son poids redoutable pour conquérir le public et le mettre en joie au détriment de ses camarades, notamment Al Saint John (1893-1963) et Buster Keaton (1895-1966) qu’Arbuckle coiffait sur les plateaux de tournage d’une autorité sans partage.
On pourrait en revanche éprouver quelque réticence à classer Buster Keaton dans la famille des augustes, malgré ses longues chaussures et ses habits trop grands. Car un auguste est un pitre, inférieur presque en tout si l’on en croît Aristote, que le public affecte parfois d’aimer, mais qu’il lui est difficile de respecter vraiment. Or, impossible de ne pas estimer Buster. Sa grâce, la pureté de ses sentiments, la puissance de son ingéniosité et sa persévérance dans l’adversité transcendent bien souvent sa modestie en héroïsme. Il est le contraire d’un bouffon ; un perdant de la société peut-être, mais un déclassé sublime. On ne peut qu’admirer.
Face à la beauté de Keaton, la laideur d’un Larry Semon (1889-1928) ou d’un W. C. Fields (William Claude Fields (1879-1946) achève de creuser l’écart. Le premier sera un auguste filiforme, fiévreux et agité, le second un ivrogne au nez rouge, désabusé, cynique et d’autant plus convaincant que ce nez d’auguste buveur, la nature le lui a octroyé à vie. Chez eux, l’ambivalence est évidente : tantôt augustes dominés, presque pitoyables, tantôt dominateurs impérieux face à plus faible ou plus infortuné qu’eux1.
Parallèlement à ces grands solitaires, les duos se développeront dans le cinéma américain dès les années 1920, selon la formule éprouvée en Europe du clown blanc détenteur de l’autorité et du savoir, et de son auguste indiscipliné, que décidément rien n’instruit. Cette formule avait le mérite de mieux incarner, en les dédoublant, les deux faces d’un seul et même personnage, rendues ainsi plus lisibles, plus caricaturales aussi, mais ouvrant de nombreuses possibilités dialectiques entre bien et mal, force et faiblesse, savoir et ignorance…
Le plus célèbre tandem fut sans conteste celui que Stan Laurel et Oliver Hardy constituèrent à partir de 1927. Cette fois encore, au moyen des physiques que tout opposait, la nature se chargea de distribuer les rôles. Comme chez Doublepatte et Patachon, Harald Madsen (1890-1949), le plus gros, et Carl Schenström (1881-1942), le maigre, leurs précurseurs danois, le gros domine le maigre, du moins en apparence. Car ici, le contraste est trompeur et la nature prise en défaut. L’originalité chez eux vient de ce que nous sommes en présence de deux augustes, dont l’un – Hardy pour ne pas le nommer – persiste à croire qu’il est né clown blanc. Or, son autorité est constamment bafouée par les frondes victorieuses de Laurel. Et comme le plus souvent c’est la victime – parce qu’elle fait rire – qui gagne la sympathie du public, les défaites régulières du présomptueux Hardy répartissent très équitablement le potentiel comique entre les deux compères, créant ainsi un heureux équilibre, rarement atteint depuis.
Abbott et Costello, Bud Abbott (1896-1964) et Lou Costello (1908-1959), dont le succès fut également immense entre 1940 et 1945, sont loin de présenter la même harmonie. Chez eux existent clairement un clown blanc rabat joie et un auguste sur qui reposent tous les effets comiques, Costello n’étant que le plat faire-valoir d’Abbott. À l’inverse de Laurel et Hardy, la permutation des rôles ne se produit jamais. L’opposition entre la sécheresse sans saveur de l’un et la joyeuse folie de l’autre est définitivement installée et ne ménage aucune surprise.
Plus près de nous enfin surgissent en 1946 Jerry Lewis (1926-2017) et Dean Martin (1917-1995). Le pitre prend cette fois l’allure d’un adolescent attardé dont les grimaces outrancières expriment la plus profonde stupidité. Jerry Lewis choisit résolument la facticité, là où Laurel, son maître, cultivait au contraire un certain naturel. Cette sorte de comique, jusqu’alors surtout réservé aux acteurs de peu de moyens, se trouve ici revalorisée par la virtuosité juvénile et l’exceptionnelle inventivité de l’interprète2. Face à lui, le crooner Dean Martin se montre un clown blanc compréhensif, parfois même complice, que le charme d’une belle voix enveloppante sauve de la banalité. Ce contraste d’un genre nouveau fonctionne un temps, avant que le couple ne se sépare en 1956 et que Jerry Lewis, désormais privé de faire valoir, se mue en auguste solitaire.
Plus rares quoique plus proches encore de la tradition historique du cirque qui, comme on le sait, faisait, à l’origine, des clowns non des artistes à l’égal des autres mais de simples supplétifs chargés de distraire le public entre les numéros nobles, sont également nés trios, quatuors et au-delà, troupes sans nombre des augustes de soirée. Au cinéma aussi les troupes fleurirent, surtout au début du siècle, mais ne connurent qu’une existence éphémère. Les trios eurent dans l’ensemble plus de chance, tels les Trois Stooges, les Ritz Brothers, sans jamais égaler toutefois, loin s’en faut, les frères Marx. Chico, Groucho et Harpo ne venaient pas du cirque, mais de la comédie musicale. Pourtant, Harpo fut un auguste inspiré, enfermé dans un monde où les adultes n’avaient pas accès, tandis que Chico et Groucho se partageaient les autres emplois, davantage en contact avec le réel. Le miracle chez eux est que chacun faisait valoir les deux autres, dans un savant équilibre, maintenu film après film.
Nous ne pouvions conclure sans rappeler, même rapidement, que nombreux parmi ces clowns furent ceux qui au cours de leur carrière voulurent exprimer tout ce que leur art devait au cirque. Chaplin bien sûr dans The Circus ou Limelight, mais aussi Harry Langdon, Laurel et Hardy, les Marx Brothers, Dany Kaye, Jerry Lewis et bien d’autres. Une nouvelle fois Buster Keaton se démarque qui, dans une œuvre pourtant abondante, ne fit jamais la moindre allusion, ni de près ni de loin, à l’univers des chapiteaux. Dans la dernière partie de sa vie pourtant, il vint à trois reprises jusqu’à Paris pour se produire sur la piste du cirque Medrano. C’était en 1947, en 1952 et en 1954. Fallait-il y voir le besoin d’un retour aux sources, le désir tardif de rendre hommage à cette vieille Europe qui avait tant donné ? Nul ne saurait vraiment le dire. Ce fut, en tout cas, à mesure qu’approchait le moment de tirer sa révérence, une façon élégante, pour celui qui fut peut-être le plus grand de tous, de se rattraper et de payer sa dette.
1. Tels Red Skelton (1913-1997), Joe Brown (1892-1973) ou Danny Kaye (1913-1987).
2. Entre les années 1990 et 2015, le comique anglais Rowan Atkinson (né en 1955) ira plus loin encore dans le jeu des grimaces, tenues en point d’orgue jusqu’à la douleur.