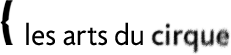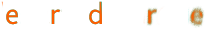par Pascal Jacob
L’art clownesque, un concept complexe à définir tant il emprunte de méandres pour se formaliser, est probablement marqué avant tout par ses facultés de mutation. On ne rit plus aujourd’hui des mêmes choses qu’il y a un siècle et la figure du clown n’échappe pas à cette évolution des intentions qui caractérise un personnage issu du théâtre et dont la formulation, tant en matière de répertoire que d’apparence, n’a jamais cessé de bouger. Le cirque contemporain ne compose pas avec le clown de manière aussi systématique qu’un cirque plus conventionnel et creuse sans doute davantage le sillon de l’humour plutôt qu’il ne cultive celui d’un rire impulsif et facile. Depuis quelques décennies, le clown s’affirme également dans des spectacles mono-disciplinaires, à l’instar des acrobates ou des jongleurs, et cette dimension a une incidence certaine sur le jeu et l’écriture scénique.
Précurseurs
Qu’il soit dialogué ou simplement mimé, l’un des axes fondateurs du registre clownesque est le répertoire. Forgé dès le XVIIIe siècle sur l’aire de jeu délimitée par Philip Astley, il s’incarne très précisément en 1768 dans La Course du Tailleur à Brentford, une saynète comique où un cavalier maladroit ne parvient pas à maîtriser sa monture et ne cesse de mordre la poussière. Astley lui-même interprète cette séquence initiale où sont synthétisés tous les ingrédients du cirque moderne : le cercle, le cheval, l’acrobatie et le rire. Cette première fusion des artifices est symbolique. Elle ancre le cirque dans la transversalité des pratiques et annonce surtout l’importance d’un registre singulier, l’humour, pour contrebalancer les émotions fortes induites par la voltige et l’équilibre.
Cette « aventure » du malheureux tailleur, inspirée par un fait divers du temps, est dotée d’une forte connotation politique, reliée à l’élection controversée du politicien John Wilkes. Philip Astley s’en empare, façonne une première entrée à succès, mais il n’imagine pas à quel point cette création va susciter reprises et adaptations d’un bord du monde à l’autre. Rognolet et Passe-Carreau, Billy Buttons, de Paris à New-York, popularisent jusqu’à la fin du XIXe siècle cette parodie équestre conçue en quelques jours pour coller à une actualité très rapidement oubliée. En quelques saisons, le Tailleur est néanmoins devenu une première figure de répertoire.
Codifications
Cette mobilité des formes est caractéristique de l’évolution du jeu clownesque. Les premiers « clowns à pied », inspirés à la fois par la silhouette du jester shakespearien et les codes d’apparence de Joe Grimaldi vont contribuer à définir les lignes de force d’un vocabulaire très physique qui ne cessera de s’enrichir au fil des saisons et de l’apparition régulière de nouveaux praticiens, à l’instar aujourd’hui d’un clown comme Ludor Citrik dont l’énergie féroce et la présence corporelle s’inscrivent dans cette continuité symbolique incarnée au XIXe siècle par les Hanlon Lees.
Cette tension entre allure et interprétation, définie notamment par l’interdiction d’user du verbe jusqu’à la chute du Second Empire en France, est néanmoins féconde. Elle notifie surtout le corps comme un artifice primordial et fait des premiers clowns des acrobates comiques. C’est une notion fondatrice, même si au fur et à mesure que la parole se libère la souplesse et la force physique relèvent davantage d’un terreau préliminaire plutôt que d’un cahier des charges obligé. Progressivement, le répertoire clownesque se formalise et se codifie, essentiellement pour répondre aux besoins des premiers duos, fondés à la fin du XIXe siècle. La nécessité d’une écriture, aussi symbolique soit-elle, conduit à d’insolites formulations, semblables aux canevas rudimentaires de la commedia dell’arte, identifiées sous le terme simplifié d’entrées comiques. Il s’agit bien de soutenir les interprètes en leur offrant une trame à partir de laquelle il est possible de broder en fonction de la personnalité de chacun. Cette « manière », très efficace pour borner le rôle du clown et de l’auguste, va traverser le temps sans réellement évoluer jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. À l’instar du cirque tout entier, le clown entame alors une mutation profonde, tant au niveau de sa mémoire que de son apparence.
Ailleurs
À la fin des années 1960, entre décalage et révérence, le jeu clownesque s’échappe du cirque pour faire évoluer ses registres et ses modes de création. Il s’épanouit désormais dans la rue ou sur la scène, territoires de ses débuts quelques siècles auparavant. Les Clowns d’Ariane Mnouchkine et les Colombaïoni, un duo d’acrobates issus du cirque traditionnel italien, mais entièrement investis dans une réinvention des mécanismes clownesques, portés notamment par l’énergie de la commedia dell’arte, représentent des jalons essentiels dans ce processus de basculement spectaculaire. Si Ariane Mnouchkine théâtralise son rapport au clown, les Colombaïoni fusionnent l’organicité de la comédie italienne et l’innocence originelle de l’auguste pour façonner des personnages singuliers capables d’improviser comme de jouer des séquences très écrites. En s’appropriant des entrées clownesques classiques, à l’instar des parodies d’Hamlet et de Guillaume Tell, ils décalent drastiquement la perception d’un répertoire considéré comme naïf et désuet. Il y a bien sûr toujours une pomme, mais la mécanique initiale de l’entrée est devenue avant tout un magnifique prétexte pour une éblouissante démonstration de virtuosité, sans le moindre artifice, basée sur une spontanéité verbale et une capacité à rebondir sans cesse en fonction des réactions du public. Cette extrême disponibilité de tous les instants, cette manière de respirer avec la salle et de moduler chaque intention selon les vibrations des spectateurs, un peu comme une houle d’énergie créatrice partagée, le groupe insufflant sans le savoir des intentions de jeu au duo attentif et perméable à la moindre inflexion, est un remarquable exercice de style qui dérègle singulièrement le ressenti accepté. Dans une certaine mesure, Ariane Mnouchkine ouvre la voie à plusieurs générations de femmes clown. Trois ans après Les Clowns, Annie Fratellini matérialise son duo avec un clown, mais beaucoup de femmes vont aussi faire le choix du solo. Léonie, Madame Françoise, Emma la clown, Hélène Ventura, Jackie Star ou Arletti imposent leurs personnages au fil des saisons, souvent sur scène, mais parfois également sur la piste.
Apparences
Les Colombaïoni décalent aussi la perception visuelle du clown : là ou Ariane Mnouchkine absorbe les codes de représentations et d’apparence tout en conservant oripeaux et nez rouge, ils délaissent les éléments du vestiaire attendu pour entrer en scène, ou en piste, vêtus comme des spectateurs. Quelques accessoires viennent compléter chemises et pantalons en fonction des séquences, mais rien ne les singularise hormis leur densité physique, perceptible dès leur entrée en jeu. Cette simplification est également déterminante pour l’appréhension des caractères et il n’est pas anodin d’avoir sous les yeux deux personnages capables d’être tour à tour le clown ou l’auguste, l’un et l’autre glissant d’un registre pour se transformer en cible ou en despote. Cette « réduction d’apparence » est commune également à un duo constitué au début des années 1990 par Aleeksenko et Jigalov, partenaires définis selon leurs singularités physiques respectives. Le premier est grand et élégant, le second est petit et emprunté. Leur comique naît à la fois de ce contraste fort, mais aussi de leur aptitude à relativiser la frontière entre l’autorité et le désarroi, la justesse et l’imprécision. L’un et l’autre sont vêtus simplement, modifiant leurs tenues en fonction des entrées, mais ils sont très loin stylistiquement du vestiaire classique. Timour et Konstantin, également formés à Moscou, s’inscrivent dans une veine identique, développant un jeu clownesque légèrement décalé tout en créant leurs propres reprises.
Initialement, Carlo et Alberto Colombaïoni jouent eux aussi des entrées, notamment pour Dario Fo, mais ils vont rapidement développer leurs propres spectacles, instaurant ainsi une autre dimension au registre clownesque. Ce nouveau rapport à la scène et au public est déterminant pour l’évolution du jeu clownesque. Dès les années 1980, c’est un mode de création séduisant pour les artistes, mais il induit inévitablement un abandon de l’entrée, format adapté à un spectacle composite.
Le silence des mots
En fondant le collectif Licedei, Slava Polunin s’appuie sur un registre clownesque à la fois très classique et très codé, mais déjà symboliquement décalé. Sa fascination pour le travail de Leonid Enguibarov nourrit sa pratique et il assume des choix stylistiques qui vont contribuer à signer l’évolution de l’art clownesque en Union Soviétique. La définition des silhouettes des différents personnages du groupe, entre épure d’une forme traditionnelle et translation d’une image immémoriale, est stimulante. Il y a là une révérence à la souplesse de la souquenille du paillasse comme de souples références à l’enfance et à la naïveté. La création de La Route de Sienne, un spectacle mis en scène par Madona Bouglione, symbolise bien cette évolution à la fois stylistique et technique. La pièce, une version inédite de Roméo et Juliette, est interprétée par plusieurs membres du collectif Licedeï, des acteurs et des danseurs. Ancrée à la fois dans la tradition shakespearienne d’un jeu entièrement assumé par des hommes et dans celle du clown, la représentation est éblouissante de virtuosité. Les Licedeï apportent notamment ce mélange d’inquiétude et de joie, propre à nourrir la poésie de Shakespeare même s’il n’y a pas un mot échangé sur scène. Les clowns font palpiter une énergie qui n’appartient qu’à eux, enrichie par une apparence extraordinaire. Sans un mot, mais avec une expressivité confondante, ils transfusent une fraîcheur nouvelle à une adaptation théâtrale d’une puissance inédite.
D’autres, à l’instar des Nouveaux Nez, de Bert et Fred ou de James Thiérrée, questionnent le répertoire et s’attachent à en revisiter les codes pour mieux les transcender. Dans La Symphonie du Hanneton, James Thiérrée insère une « vieille » entrée, le Miroir brisé, mais en donne une adaptation d’une intelligence fulgurante. Face à son double, vêtu comme lui d’un basique pyjama blanc, il interprète une séance de rasage matinal rythmée par la musique dispensée par un transistor. Chacun des « reflets » l’enclenche ou l’interrompt et si la structure de l’entrée est soigneusement conservée, elle est néanmoins subtilement déplacée pour devenir une séquence comique très contemporaine, nourrie par une trame ancienne. Les conventions du « miroir » sont respectées, mais la finesse de l’interprétation les rend peut-être encore plus justes que lorsque l’entrée est jouée avec un lourd cadre doré. Ce décalage inspiré suggère également en creux que certains fragments traditionnels ont finalement de beaux jours devant eux.
Le trio Monti, composé d’un blanc et de deux augustes, soucieux de perpétuer un modèle comme d’en façonner les effets à leur main a réussi pendant quelques saisons à interpréter plusieurs entrées classiques, notamment sur la piste du cirque Roncalli. En stylisant leurs silhouettes tout en s’appuyant sur une extrême complicité, les trois membres de ce trio sont parvenus à restituer avec justesse l’esprit qui devait animer les Fratellini tout en transcendant leur jeu. Cette interprétation, pour partielle qu’elle soit, ravive la mémoire, mais elle est également empreinte d’une certaine modernité. Le trio Monti a stigmatisé la force de rouages éprouvés sans en bouleverser les structures, mais d’autres ont su, à l’instar de la compagnie Trottola, réinventer des mécanismes magnifiques. Le spectacle Matamore est tout entier imprégné du sens profond de ce qui constitue la vis comica depuis plusieurs siècles et sa manière de tramer sa propre dramaturgie avec des éléments saillants empruntés à l’histoire est remarquable. Puissamment incarnés, les personnages créés par les artistes de la compagnie marquent le temps de l’évolution d’un jeu clownesque aux ressources inépuisables.
Cette évolution des caractères, du répertoire et de l’apparence, est révélatrice d’un attachement à ce qui fonde intuitivement les principes d’une narration atypique, longtemps liée à un contexte particulier. L’évolution la plus notable est sans doute celle d’un processus narratif toujours plus abstrait, étayé d’impulsions créatives et d’intentions littéraires ou picturales. Ce qui nourrit des formes clownesques comme Le Syndrome de Cassandre ou Par le Boudu tient à la fois du vif et de l’indicible, une autre manière de faire palpiter l’existence et d’entraîner le spectateur là où il n’a pas toujours envie d’aller. C’est une rupture fondamentale avec ce que l’art clownesque a longtemps généré au cours de son intégration sur la piste du cirque, même si certains artistes ont parfois tendu au public un miroir déformé de sa propre condition. Foottit ne s’en cachait pas, revendiquant ainsi une part de sa violence en piste, la justifiant même par l’observation acérée du comportement de ses contemporains. Un ferment qui trouve un étrange écho dans les quelques lignes destinées à décrire le bouleversant Par le Boudu, créé et interprété par Bonaventure Gacon : « Il a un peu mal au cœur, trop bu… Sans doute le foie, les petites bières ou peut-être le cœur lui-même, son pauvre cœur d’ogre, ou bien cette satanée rouille qui inexorablement agit sur toutes choses, sur les poêles, les cœurs et le reste… Enfin, il faut bien se remettre au boulot, aller voir les bons petits gars et les petites filles, siroter quelques verres, regarder les couchers de soleil, se faire des petits gueuletons et puis être méchant du mieux qu’on peut.
Faut bien vivre !… »