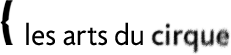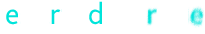par Pascal Jacob
Lorsque Archangelo Tuccaro, « Saltarin du Roy », publie à Paris en 1599 ses Trois dialogues de l'exercice de sauter et voltiger en l'air, il contribue à populariser l’acrobatie et s’inscrit dans la continuité de l’ouvrage De Arte Gymnastica publié à Venise en 1569 par Girolamo Mercuriale. Ces deux livres constituent les premières théorisations du geste acrobatique, mais ils suggèrent surtout son inscription dans une perspective sociale et littéraire par l’émergence d’une culture physique au sens littéral du terme.
Du rituel au spectacle
Définir l’acrobatie avec précision est un exercice périlleux car le terme désigne aujourd’hui, comme à l’origine, une multitude de disciplines qui procèdent peu ou prou d’un même concept initial. Forgé du grec acros, extrême, et bates, marcher, avancer, le terme induit une idée de progression mais aussi de décalage avec le commun des mortels : il désigne tacitement toutes celles et tous ceux qui jouent de ce principe d’extension et de renversement, c’est-à-dire les danseurs, les funambules et les sauteurs au sol. Tous sont des acrobates. Ils se « déplacent sur les extrémités », les mains ou les pointes des pieds, et fondent une première diaspora artistique singulière et symbolique. Le jongleur médiéval, fin diseur, chanteur et manipulateur d’objets est aussi parfois un acrobate : capable de sauter, de se tenir en équilibre sur une jambe ou de marcher sur les mains, il multiplie les savoir-faire et identifie à lui seul toute une caste. Dans une certaine mesure le terme « acrobate » s’est substitué à celui de « jongleur », qui désigne aujourd’hui une arborescence de disciplines autour de la manipulation d’objets, mais également de celui de « saltimbanque », désormais connoté de manière péjorative, et de « tumbeor », un terme issu de l’anglais tumbler – du verbe tumble, « culbuter » – qui définit tous ceux qui font profession de sauter et d’enchaîner les culbutes. La pratique actuelle du tumbling, évidemment, est nourrie de cette influence.
Une arborescence de formes
Ce qui caractérise l’importance de l’acrobatie, c’est le développement de la terminologie liée à sa pratique. Le cybisteter grec, le cernuus latin, un mot issu du verbe cernuo, « tomber la tête en avant », « faire la culbute », comparable à une forme de bateleur, définissent ce que nous considérons aujourd’hui comme des équilibristes et le funambulus et l’oreibate identifient les praticiens du fil. L’acrobatie est une arborescence de formes, mais aussi un vocabulaire partagé par toutes les disciplines. Elle est un langage, spectaculaire et universel, mais aussi un jeu, intuitif et dynamique autour du corps et de son explosivité, de sa puissance et de son élégance.
Pourtant le jeu, sinon l’enjeu, justement n’est pas gratuit. On retrouve cette frénésie, cette puissance et cette élégance dans une fresque découverte à Cnossos, peinte en 1 500 av. J.-C. et qui représente de jeunes acrobates qui s’élancent au-dessus des cornes d’un taureau en pleine course. Pour qui serait tenté d’y voir les prémices de la corrida, on répondra que la cambrure des sauteurs renvoie davantage à une conscience du saut qu’à une simple volte pour échapper aux cornes de la bête… La cambrure justement, attestation d’une souplesse savante, renvoie à son tour à d’autres fresques, élaborées deux millénaires avant notre ère et révélées en Égypte comme autant d’ébauches d’une science du corps aussi spectaculaire que sacrée.
Originellement, l’acrobatie est tout à la fois formulation d’un rite et dévoilement d’une sagesse secrète. Au cours de la période Antique, à Sumer, en Égypte ou aux confins de l’Indus, sa pratique est souvent liée à des cérémonies funéraires. Le saut ou la souplesse y ont une fonction conjuratoire en opposant à la mort présente une succession de figures représentant la vitalité irrépressible de la vie. En dominant symboliquement son corps, l’acrobate est une figure de progrès : nul renversement n’échappe à son rétablissement, source de renaissance et traduction d’une transition d’un monde à l’autre. On trouve aujourd’hui encore cette dimension funéraire dans la liturgie taoïste où certaines cérémonies sont exécutées par des prêtres acrobates. Ils illustrent chacune des étapes du voyage du défunt vers l’au-delà par des performances symboliques où entrent en jeu manipulation d’objets, sauts et acrobatie au sol. Le rituel peut se dérouler en plein air, au milieu de la ville, sans être interrompu par les turbulences de la vie quotidienne.
Inspirations
Les racines de l’acrobatie sont planétaires et multimillénaires. Ce sont des rites d’imitation du comportement des animaux qui vont être à l’origine du développement des premières formes acrobatiques. Pour convaincre les dieux de placer sur la route des chasseurs le plus grand nombre de proies, le groupe va imiter certaines créatures de la manière la plus explicite, en se parant de plumes, de cornes ou de peaux pour en augmenter le réalisme et dissiper les dernières hésitations des puissances bienveillantes... La rapidité, la force, l’agilité et la souplesse caractérisent de nombreuses espèces : en les imitant, en sélectionnant au sein du clan les individus les plus doués, les hommes vont peu à peu acquérir les mêmes aptitudes. La compréhension de ces étranges savoir-faire va inciter à la compétition pour l’exactitude et la virtuosité.
Lorsque les communautés de chasseurs cueilleurs deviennent des sociétés sédentaires d’agriculteurs éleveurs, elles conservent la mémoire de ces rites de chasse et en font progressivement un vocabulaire artistique et profane. L’acrobatie spectaculaire est née. De ces jeux d’imitation, de ces plaisirs de compétition pour escalader le plus rapidement possible un arbre, de cette aptitude à rendre la reptation plus vraie que nature, de cette nécessité de se soutenir et de se porter pour aller toujours plus près des étoiles, vont naître des techniques circassiennes comme le mât chinois, la contorsion, l’équilibre, les pyramides, les portés et le main à main… Séculaires, ces figures et ces rituels orchestiques résonnent désormais comme une mémoire fécondante : l’acrobatie contemporaine n’a pas d’autres sources, même si, bien sûr, elle n’a cessé de se développer et de s’enrichir à partir de ce socle puissant et symbolique, alimenté par les croisements et les interprétations.
Les caravanes qui traversent inlassablement les terres lointaines de l’Asie Centrale pour venir déposer aux portes de l’Europe les marchandises les plus extraordinaires, comme les expéditions guerrières de Gengis Khan et de ses descendants qui s’approprient hommes et trésors, vont assurer le lien et la dispersion de jeux d’adresse, de performances et de manipulations virtuoses. Tout au long des routes de la soie, trait d’union entre l’Orient et l’Occident, un répertoire universel se constitue, par le jeu des rencontres, des confrontations, des échanges et des agrégats, une sorte d’inventaire des prouesses, passerelle intuitive entre les hommes et les civilisations.
Migrations tsiganes
C’est à mi-parcours d’une histoire qui traverse deux millénaires, vers le Xe siècle, qu’un peuple tout entier se met en marche pour échapper à la famine et aux exactions des autres communautés. Cette immense migration aux allures d’exode est la métaphore de ce qui va le constituer pour les dix siècles à venir : l’errance va devenir son mode de vie et l’ailleurs son objectif… Guidé par les étoiles, organisé en troupes de plusieurs dizaines, voire centaines, d’individus, le peuple tzigane s’ébranle pour la plus longue marche de son histoire. Ils abandonnent le Nord de l’Inde et lentement, au pas des hommes et des bêtes, ils cheminent en quête d’un territoire plus sûr pour protéger leurs familles. La route, aléatoire, est interminable : il va leur falloir plusieurs siècles pour parcourir des milliers de kilomètres et parvenir, pour certains, au seuil de l’Europe aux alentours du XIVe siècle. Ils sont porteurs de connaissances étranges et inédites, héritées de formes anciennes, entre mythes et rituels.
Le Kalarippayatt est une danse guerrière et acrobatique originaire du Kerala, un état de l’Inde du sud, dont les premières traces sont attestées par des dessins sur des feuilles de palmier datant du IIe siècle avant J.-C. Le Kalaripayatt se codifie au XIIe siècle et connaît un âge d’or entre le XVe et le XVIIe siècle. Considérée comme l’ancêtre des arts martiaux, cette danse est nourrie de références puissantes. Elle puise son inspiration dans la culture dravidienne, liée à la connaissance des règnes animal et végétal, bouddhiste au travers de la science du corps énergétique et aryenne avec les techniques holistiques de domination et de conquête. Ses pratiquants, entraînés dans le kalari, une petite arène fermée de 14 mètres sur 7 et couverte de sable, exécutent des sauts prodigieux mais sont aussi capables de se mouvoir silencieusement, développant une forme de mimétisme animal. L’énergie et la force déployées donnent une dimension spectaculaire aux affrontements, amplifiée par une gestuelle à la fois fluide et précise. À l’autre extrémité de cette danse de guerre, le Gotipua, est une danse pacifique de l’état d’Orissa, interprété depuis le XVIe siècle par de jeunes garçons vêtus de chatoyants costumes féminins. Mélange de contorsion et d’acrobatie, le Gotipua honore le dieu Krishna et offre une étonnante synthèse entre performance et chorégraphie, soutenue par des rythmes percussifs, amplifiés par le martèlement rythmique des pieds des danseurs.
Le mallakhamb, une pratique méconnue initiée en Inde à partir du XIIe siècle, forgée à partir de malla, homme fort et khamb, un pilier, est une discipline sportive codifiée au XVIIIe siècle dans l’état du Maharastra et largement développée au siècle suivant sous l’impulsion de Sir Balambhatt Dada Deodhar. Pratiquée avec un mât de teck ou de bois de rose de trois mètres de haut, elle consiste à enchaîner un maximum de figures en une minute trente. Le mât est soigneusement poli et huilé pour éviter les aspérités qui pourraient blesser ses pratiquants, simplement vêtus d’un pagne de couleur orange. Les prises et combinaisons sont spectaculaires et mêlent une extrême souplesse des épaules à la force et la rapidité. Purement gymnique, très encadré depuis 1958 avec des compétitions régionales et nationales et un code de pointage très précis, le mallakhamb, sorti de son contexte sportif, est néanmoins régulièrement présenté comme une attraction à part entière. En 2009, le spectacle India, conçu par Franco Dragone pour Prime Time Entertainment, révèle un collectif de huit pratiquants du mallakhamb, totalement chorégraphié et détaché de toute connotation gymnique. Le Dai Show, spectacle permanent également créé par Franco Dragone à Xishuangbanna en 2015, intègre une séquence de mallakhamb.
Ces formes chorégraphiques et acrobatiques, imprégnées de nombreuses références au sacré, s’accordent aux autres repères qui structurent l’évolution de l’acrobatie tout autant que notre vision de cette discipline. Chez les Anyi du Ghana, à l’occasion de certaines cérémonies, un cercle est tracé avec de la poudre de kaolin pour constituer une aire sacrée et éphémère. À l’intérieur de cet espace circulaire évoluent plusieurs officiants aux rôles définis et qui incarnent notamment clowns et démons, identifiés par leurs maquillages et leur registre physique. Sauts, culbutes, gestuelle grotesque et conjuratoire composent un vocabulaire symbolique, compréhensible par les initiés et l’ensemble de l’assistance et qui relève à la fois du théâtre, de la danse et de l’acrobatie.
L’étude des incunables, manuscrits et livres d’heures, révèle de jolies surprises : c’est là, dans la gloire d’enluminures d’une étonnante fraîcheur, en marge de lignes savamment tracées, que dansent les jongleurs et s’animent les acrobates. Un merveilleux corpus imagé qui suggère à quel point la virtuosité de quelques-uns a réussi à transcender l’imaginaire de beaucoup d’autres. Entre deux colonnes striées d’or, magnifiées par deux gouttes de carmin, inscrit dans les marges d’un assemblage de pensées et de références éternelles, un contorsionniste incarne à lui seul l’ambivalence de sa virtuosité. Comparable à un démon, tout autant qu’à une figure tutélaire de renversement et d’évolution, il sublime avec justesse la fragilité de l’existence et renvoie celui qui le contemple à sa propre vanité…
Incarnation et transition, l’acrobate rejoue à chacun de ses déséquilibres l’intensité du passage de la mort physique à la résurrection spirituelle, mais il s’insère aussi dans la sphère artistique du temps.
Aux sources de la Banque
Parallèlement, les chantiers de construction des cathédrales représentent un formidable laboratoire d’intégration du geste acrobatique dans le vocabulaire visuel médiéval : acrobates et jongleurs s’inscrivent au faîte de colonnes de pierre, mais ils trouvent aussi leur place dans les bas-reliefs qui constituent les fresques en trois dimensions destinées à orner les portails, restitution sculptée des scènes qui animent les Mystères donnés sur les parvis. Façonné, sacralisé, le corps disloqué ou triomphant, l’acrobate symbolise et reflète la fascination immémoriale pour les jeux d’adresse et la puissance d’évocation du geste extraordinaire, alphabet et vocabulaire inédit. Siècle après siècle, une arborescence de techniques et de disciplines se transforme progressivement en un puissant tronc commun. Ainsi vont naître, se nourrir et se croiser quelques-unes des disciplines fondamentales de l’histoire de l’acrobatie dont les gestes et les postures constituent peu à peu un répertoire universel et façonnent le socle de la Grande Banque d’Occident. Par banque, il faut entendre diaspora, communauté encore. Le mot dérive du terme saltimbanque, un vocable issu de l’italien ancien saltare in banco, littéralement sauter sur le banc, les tréteaux, l’estrade des baladins qui leur permet de dominer la foule pour accomplir leurs tours et débiter leur boniment.
De ce saltimbanque, à la fois noble et péjoratif, s’élabore une arborescence de mots aussi étranges qu’explicites : de la banquette à la banquine et de la banque aux banquistes, tous ont en commun cette origine amusée où le banc est aussi parfois celui du changeur, c’est-à-dire le banquier… Un parfum d’argent et de divertissement, une alliance aux allures de prémonition, une proximité ambiguë et une relation qui dure encore… La banquette est ce petit talus de terre ou ce tour de bois coiffé de velours rouge qui enserre la piste et constitue un rempart symbolique mais infranchissable. Le saut de banquine est une technique de propulsion humaine où deux porteurs poussent et rattrapent un voltigeur, la banque identifie l’ensemble de la diaspora composée des banquistes.
La fin d’un monde
Les saltimbanques qui arpentent les chemins et se produisent au hasard des étapes, récurrents depuis Thespis et son chariot en Grèce, sont considérés comme malfaisants et excommuniés au même titre que les acteurs depuis le IVe siècle et le concile d’Elvire en Espagne en 305. Difficile d’assimiler alors ces « vagabonds » au corps social, d’autant que la sédentarité est la norme et que les famines dues aux mauvaises récoltes, les rapines de troupes de mercenaires ou de rouliers sans feu ni loi, sans oublier les épidémies qui font rage dans certaines régions n’incitent pas à la tolérance pour une quelconque différence : le voyageur, l’autre, est alors inévitablement considéré comme responsable de tous les maux du siècle. Une alternative leur est pourtant parfois offerte sous la forme des corporations, guildes et ménestrandies qui rassemblent, fédèrent et protègent les représentants d’une même profession. Et, à l’instar des bouchers, des tailleurs ou des tanneurs, les jongleurs ont parfois une rue, un quartier, voire un hôpital qui leur sont réservés. Inscrits dans la trame de la cité, ils acquièrent ainsi un début de respectabilité. Cette idée suggère en creux celle de troupe et, partant, de clan, de famille et de dynastie. L’appartenance à un même sang fonde la corporation. Il y a là un pont symbolique avec l’organisation des guildes anciennes, mais où le talent a valeur de sésame et de raison d’être.
Les grandes foires, rassemblement d’activités multiples et gigantesques foyers de rencontres, ont toujours été des lieux de prédilection pour les saltimbanques de toutes origines, certaines leur offrant même des quartiers entiers, des ruelles bordées de loges où se produisent danseurs de cordes, manipulateurs d’objets et montreurs de bêtes. Territoires urbains vibrants où alternent et cohabitent la science, le spectacle et le commerce, les foires attirent des milliers de badauds, public régulier et surtout captif. Ceux qui vendent pommades et onguents, charlatans de la première heure, s’allient parfois la virtuosité d’un saltimbanque pour vanter ses produits. Un saut, une pirouette ou un bon mot suffisent à attirer le chaland au pied de l’estrade, où, sans doute, fasciné, il finira par céder au boniment et repartira lesté d’un baume ou d’un pot de poudre miraculeuse.
Un édit royal de 1719, conquis de haute lutte par la Comédie Française pour en finir avec une concurrence jugée déloyale, va finir par réguler cette chaude extravagance des foires, en outre associées trop souvent à des débordements et une contestation qui fragilisent le pouvoir. Progressivement réduites et interdites, elles jettent sur les routes les innombrables saltimbanques qui ont contribué à leur expansion et leur fortune. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, danseurs de corde, jongleurs et acrobates font alliance avec les premiers voltigeurs à cheval. Inspiré, influencé, nourri par l’acrobatie, le cirque moderne entre en scène pour le premier acte de son histoire.