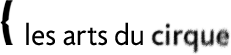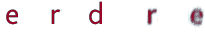par Pascal Jacob
Lorsque le rideau se lève sur le Théâtre du Cirque Olympique le jeudi 21 avril 1831, les attentes sont immenses : pour la première fois, des « bêtes féroces » sont offertes à l’admiration du public dans un autre contexte que celui des ménageries à l’atmosphère enfumée et sombre. Elles sont devenues des partenaires de jeu, pour ne pas écrire des « actrices », aux côtés de comédiens prudents et de leur dompteur omniprésent.
La trame des Lions de Mysore n’est qu’un prétexte : selon le frontispice de la pièce, celle-ci « a été arrangée pour placer convenablement les animaux dressés par M. Martin ». Le propos est clair, mais n’en demeure pas moins intrigant. Les fauves du premier dompteur de l’histoire moderne n’apparaissent qu’au deuxième acte, mais la réaction des spectateurs conforte les promoteurs du spectacle qu’il y a bien là un beau filon à exploiter. La cohérence zoologique est sérieusement mise à mal par la présence de deux lamas et d’un kangourou, mais l’heure n’est pas encore à l’exactitude des faits et la nouveauté du genre séduit par son exotisme bon enfant et surtout la présence bien réelle de fauves en chair, en griffes et en os.
Les Lions de Mysore ouvrent la voie à un type de spectacle singulier, la pantomime à caractère exotique, une forme théâtrale qui prend la place des reconstitutions militaires à la gloire de l’Empire qui ont fait les beaux soirs du Cirque Olympique jusqu’à la chute de Napoléon 1er. Si dix ans plus tôt, L’Eléphant du Roi de Siam pièce en trois actes et neuf parties, est créée le 4 juillet 1829, prétexte déjà à intégrer Melle Djeck, l’éléphant asiatique de M. Huguet pour une scène évidemment spectaculaire, la présence du pachyderme préfigure surtout les pantomimes exotiques à venir avec des fauves toujours plus nombreux.
Martin est un habile dompteur, mais Van Amburgh et Carter, respectivement citoyens américain et britannique, capitalisent avec leurs personnalités différentes sur le succès des exhibitions du dompteur français. Van Amburgh débarque de Londres où il a triomphé dans la pantomime Charlemagne et il s’installe au théâtre de la Porte Saint-Martin avec toute sa ménagerie. Pour tenter de tenir le public en haleine, La Fille de L’Emir est jouée après un vaudeville, mais le public, galvanisé par les rugissements et l’odeur des fauves détenus en coulisse, invective les acteurs qui doivent quitter la scène avant la fin de la pièce sous une pluie de quartiers de pommes et de noyaux tandis que la foule hurle « Les bêtes ! Les bêtes ! ». Lorsque la toile se lève enfin sur Van Amburgh, un silence à la fois effrayé et respectueux remplace les cris : le dompteur est supposé incarner un personnage, mais c’est la présence d’un agneau à ses côtés qui fascine le public. À Londres, pour les besoins de l’intrigue il est entré dans la cage avec une fillette : à Paris, c’est un petit mannequin de bois et de tissu qui joue le rôle, mais les fauves, eux, sont bien réels ! Le triomphe est à la hauteur des attentes : l’écrivain et chroniqueur Théophile Gautier en fait un feuilleton très suivi sans lésiner sur les superlatifs et les allusions : « Jamais entrée de Talma, même celle d'Hamlet, où il arrivait à reculons, poursuivi par l'ombre de son père, n'a produit autant d'effet que celle de Van Amburgh, l'angoisse serrait toutes les poitrines, le sang refluait à tous les cœurs. » (![]() lire l'article entier)
lire l'article entier)
Le 1er octobre 1839, James Carter monte sur la scène du Cirque Olympique pour incarner le bédouin Abdallah dans Le Lion du Désert, une pièce où il affronte tigre, lion et léopard en contrepoint d’une trame très mince, mais dans laquelle les auteurs ont néanmoins veillé à lui couper la langue puisqu’il ne parle pas un mot de français ! Carter n’est pas moins bon que Martin ou Van Amburgh, mais le public se lasse déjà de ces exhibitions un peu forcées et les critiques s’amusent de la docilité des fauves : en les qualifiant de féroces, Buffon s’est visiblement trompé puisqu’avec Carter, dit-il, « un tigre énorme et un lion colossal souffrent des traitements que ne souffriraient pas le chat le plus familier et le caniche le mieux dressé. » (![]() lire la critique de Théophile Gautier)
lire la critique de Théophile Gautier)
La vogue de ces créations poussives, où seules les bêtes assurent le succès, s’essouffle rapidement. En 1891, comme une tentative de renouer avec l’esprit de ces successions de tableaux vivants, la quatrième reprise de Néron à l’Hippodrome de l’Alma, sur une musique d’Edouard Lalo, s’impose comme une fresque spectaculaire où des fauves sont convoqués pour une séquence effrayante. Les lions s’arrachent en rugissant des mannequins façonnés avec des quartiers de viande, créant à la lueur des torches des images saisissantes, mais en dépit de cette reconstitution sanglante, contrepoint brutal à d’autres séquences plus évocatrices de la grandeur romaine, la ferveur du public français n’est plus la même…
Désormais, les fauves se suffisent à eux-mêmes et vont progressivement constituer un simple numéro inséré dans un spectacle où cohabitent écuyers, acrobates et clowns. En Allemagne néanmoins, la pantomime continue de faire recette et les troupes des cirques Renz ou Busch maintiennent cette tradition de la fresque animée en intégrant ponctuellement les créatures les plus exotiques de leurs ménageries. Le 13 mai 1900, la création de Vercingétorix sur le sable de l’arène de l’Hippodrome de Paris, sur un livret de Victorin Jasset et une composition musicale de Justin Clerice met en scène la reconstitution d’un Triomphe comme les affectionnaient les romains avec 850 figurants, des princes africains, les fauves du dompteur Richard List, des éléphants, des dogues de combat… Manuel Orazi crée de somptueuses affiches pour ce qui s’annonce comme l’ultime « fresque animée » du genre : le cinéma ne va pas tarder à prendre la relève avec des moyens et des ressources spectaculaires sans commune mesure avec ces machineries théâtrales...
Néanmoins, jusque dans les années 1920, les Américains ne sont pas en reste et produisent de fastueuses extravaganzas où là encore, comme pour Salomon et la Reine de Saba, leurs collections d’animaux exotiques sont largement mises à contribution.
Le 13 octobre 1933 a lieu au Cirque d’Hiver dirigé par Gaston Desprez, l’unique représentation de la pantomime Tarzan le maître de la Jungle, une pantomime dont les décors et les costumes ont été loués au cirque allemand Busch. Pour des questions de droits non acquittés et pour éviter de fâcheuses poursuites diligentées par les ayants droits d’Edgar Rice Burroughs, Tarzan est vite remplacé par Les Fratellini en Afrique, une pochade rapidement réglée par le jeune metteur en scène Géo Sandry appelé à la rescousse par Desprez. En 1934, les frères Bouglione prennent la direction du Cirque d’Hiver. Avec Géo Sandry, l’homme providentiel qui a mis en scène la plupart de ces compositions spectaculaires, ils développent un genre inédit, assimilé à des opéras de cirque ou comme une variation décalée brodée sur le thème des opérettes à grand spectacle qui font la gloire de certains théâtres.
La Perle du Bengale, créée en 1935, présentée pendant plusieurs mois à Paris et en tournée, mise à l’affiche à plusieurs reprises jusque dans les années 1950, est sans nul doute le plus grand succès de la nouvelle direction du Cirque d’Hiver. En 2011, à l’occasion des spectacles produits pour les fêtes de fin d’année, La Perle du Bengale reprend du service sous la forme d’une longue séquence du programme concocté par la famille Bouglione présenté dans une vaste salle au Bourget. La pantomime d’origine y est « réincarnée » par un numéro dont les décors, les costumes et les multiples animaux présentés sont une évocation des fastes passés de la production initiale.