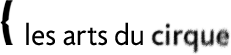par Jean-Michel Guy
Du jongleur brésilien qui essaie de gagner quelques sous en épatant les automobilistes au feu rouge, aux ensembles, synchronisés à la milliseconde, d’acrobates chinois aux talents indépassables ; des projets de « cirque social », œuvrant, dans un nombre croissant de pays, à la réinsertion de jeunes à la dérive, aux créations avant-gardistes qui poussent le cirque dans de tels retranchements qu’on hésite à les attribuer à ce genre ; du petit cirque itinérant qui parcourt les routes d’Europe en roulotte, aux « conventions »1 de monocycle, qui réunissent régulièrement les amateurs de ce très écologique véhicule ; du Cirque du Soleil, florissante industrie canadienne de spectacles, à l’infographiste qui conçoit des logiciels sophistiqués de jonglerie, voire des œuvres de cirque virtuel : le cirque, extrêmement divers et éclaté, peut être vu comme un « continuum discontinu » de pratiques, c’est-à-dire comme un archipel, ainsi que l’a décrit Gwenola David2.
En ajoutant mille dimensions à cette image plane, on le comparera plutôt à un réseau, reliant, par des liens plus ou moins solides, et sous une quasi infinité de rapports (la fonction sociale, la visée esthétique, l’ontologie de la pratique, ses valeurs, ou plus prosaïquement, les agrès, les lieux, etc.), le jongleur brésilien des rues au concepteur d’un cirque numérique. D’ailleurs, dans ce cas précis, l’extrême opposition apparente s’avère une proximité immédiate : c’est sur Internet, au Brésil, que l’on peut, lorsqu’on habite à 5 000 km de la plus proche école de cirque, se former aux techniques de jonglerie les plus avancées, et prouver à l’automobiliste de Manaus qu’un jongleur pauvre n’a rien à envier, techniquement, à un Chinois surentraîné. On ne peut découper un réseau ; tout au plus isolera-t-on des zones, relativement autonomes, agrégeant un nombre suffisant de dimensions discriminantes pour dessiner des constellations pertinentes, des îles, donc, pour simplifier.
Trois paradigmes du cirque
D’emblée, trois grands ensembles se détachent : le cirque classique, le cirque contemporain et le cirque culturel.
On appellera « cirque classique » la première « île-continent » – une véritable Australie – la notion de classicisme renvoyant partout à une norme simple, ancienne. En certains endroits du monde contestée, elle peut être ailleurs incontestable et comme naturalisée. L’appellation de « cirque traditionnel », courante en Europe, (depuis son identification dans les années 1980 en réponse à l’émergence d’un « nouveau cirque ») et parfois revendiquée contre une certaine modernité, n’est guère pertinente car elle fige en « tradition » un état en réalité très circonscrit – aux années 1950 et 1960 –, et très « construit » de l’histoire du cirque. Elle place aussi à tort sur le même plan des pratiques réellement traditionnelles – ou en tout cas fort anciennes et toujours perpétuées – comme les compétitions de voltige équestre en Mongolie et un genre occidental en constante évolution.
On appellera « cirque contemporain » le second archipel – ici s’impose par exemple l’image d’une Indonésie multiculturelle – qui se caractérise a minima par une contestation du classicisme ou de certains de ses traits. Il ne sait d'ailleurs pas très bien comment se définir autrement, mais tâche d’y parvenir, ce que la recomposition permanente de ses frontières internes l’empêche de faire, lui conférant ainsi une identité perpétuellement instable, insatisfaite d’elle-même, introuvable en dehors même du principe de labilité. On qualifie ce cirque de contemporain, pour plusieurs raisons. D’abord parce que l’expression « cirque moderne » (susceptible de s’opposer à l’expression « cirque classique ») a un sens précis pour les historiens : elle désigne un genre de spectacle, inventé dans le dernier quart du XVIIIe siècle en Angleterre, par opposition à un cirque non qualifié, un cirque d’« avant le genre ». Le mot « cirque », il est vrai, ne désigne – avant que Charles Hughes ne crée, en 1782, son Royal Circus –, qu’un lieu, cet espace ovale où se déroulaient, dans l’Antiquité romaine, des courses de chars – agrémentées, certes, de démonstrations de talents acrobatiques variés. L’expression « cirque moderne » renvoie donc à ce qui fut inventé en Europe entre 1768 et 1850, même si l’historienne Caroline Hodak pense qu’il est plus judicieux de parler de « théâtre équestre » pour qualifier ce nouveau genre, et de réserver le mot « cirque », aux spectacles qui, précisément, s’en sont, par la suite, affranchis.
La deuxième raison est que l’expression « nouveau cirque », qui s’est imposée en France à la fin des années 1980, est historiquement datée, elle aussi, et ne correspond plus, en France du moins, à la vision extrêmement ouverte que les artistes du « cirque contemporain » se font de leur art. Nouveau s’oppose à ancien : l’adjectif disait, dans les années 1980, qu’un « autre cirque » ou du « cirque autrement » était possible, et disqualifiait implicitement le cirque d’alors – réputé seul et unique – en en faisant une discipline dépassée, « fermée à l’autre, au présent ». La nouveauté, à l’époque, c’était la théâtralisation, ou plus généralement, la recherche d’un « sens » que la simple monstration d’un talent (savoir jongler, par exemple) n’était pas censée pouvoir véhiculer seule. À l’époque, seuls le théâtre ou la narration, même non verbale, semblaient détenir ce pouvoir. Le « nouveau cirque » français, si étrange aux yeux de beaucoup d’étrangers, a d’ailleurs été fréquemment rebaptisé « cirque-théâtre » ou « théâtre de cirque » – en particulier en Scandinavie – ou parfois acclimaté : au Japon, « nouveau cirque » n’est pas traduit et se prononce à la française. On a sans doute beaucoup exagéré l’importance de la « stratégie de reconnaissance » que les artistes français, pionniers du nouveau cirque, auraient poursuivie en empruntant au théâtre – art reconnu et légitime –, dans le but d’anoblir leur art, non verbal, réputé simplement divertissant et « muet » sur les questions du monde.
Le sens était capital, et le passage par le théâtre presque obligé, comme l’étaient d’ailleurs la référence et la révérence au cirque « classique », mais la quête d’une reconnaissance par les pouvoirs publics fut tardive, et ne put, d’ailleurs, se formuler comme telle qu’avec l’arrivée du Parti Socialiste au pouvoir en 1981 (même si, en 1978, à l’initiative du Président Valéry Giscard d’Estaing, les « affaires du cirque » qui étaient jusque là traitées selon les cas par divers ministères, dont celui de l’agriculture, étaient devenues de la compétence exclusive du ministère des affaires culturelles).
Le « nouveau cirque », c’est d’abord cela : une génération d’artistes qui souhaitait, tant par souci politique qu’artistique, obtenir la reconnaissance du cirque en tant qu’art (que marque en France, l’activisme syndical) et qui a finalement engendré un genre qui les dépasse, le cirque contemporain (on ne retiendra pas ici l’appellation de « cirque de création », qu’un syndicat français a choisi pour intitulé, car après tout le cirque classique sait aussi être créatif).
Contemporain, le cirque ne l’est pas en raison de son actualité ou de sa jeunesse : tout comme la « danse contemporaine », quinquagénaire, aujourd’hui enseignée dans des écoles au même titre que la danse hip-hop ou la danse jazz, l’adjectif qualifie un genre, ou mieux, une attitude, bien décrite par le philosophe Christian Ruby : être en permanence dans un état de contestation de son propre temps. Une telle définition autorise l’avant-garde, mais ne s’y réduit pas ni ne l’appelle : elle accueille le temps « hyperprésent » du clown, ne dédaigne pas la mémoire, et, surtout, se sait par avance datée, ce qui implique, pour les créateurs, un saut perpétuel dans l’inconnu.
1. Ce terme américain qui signifie « congrès » s’est imposé pour désigner les rencontres de jongleurs, d’acrobates.
2. Gwenola David, Les Arts du cirque. Logiques et enjeux économiques, La Découverte, Paris, 2006.