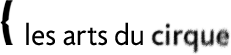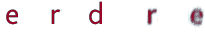par Pascal Jacob
L’éducation des animaux, basée sur l’imprégnation et l’apprentissage, se divise en deux grands courants qui vont façonner deux paysages bien distincts : l’élevage et le dressage. Corollairement, apprivoisement et apprentissage contribuent à stabiliser un faisceau de techniques où contraintes et récompenses vont de pair pour obtenir sauts, équilibres et attitudes anthropomorphiques.
Savants et sujets
Le Théâtre de l’Italien Jacques Corvi (1814-1890), fondé vers 1840, associe des singes et des chiens pour juxtaposer des saynètes inspirées par des faits divers ou des séquences issues de la vie quotidienne. Le dresseur russe Vladimir Dourov en 1907 ne fait pas autre chose quand il crée une attraction d’un genre particulier destinée à occuper la seconde partie d’un programme. Un train miniature, une gare, un aiguillage et tout un petit peuple d’animaux rassemblés sur la piste pour illustrer une fresque ironique et décalée.
Dotées de facultés de compréhension exceptionnelles, les différentes races de chiens s’appliquent notamment à jouer une multitude de rôles établis en rapport avec leur taille, leur puissance, leur malléabilité ou leur férocité. La diversité des races offre un éventail de possibilités inhabituel aux dresseurs qui choisissent de présenter des chiens.
Aux 40 comédiens canins, toutes races confondues, d’Arthur von Lipinski répondent les pékinois de David Rosaire, les dalmatiens de Madame Lorent, les teckels de Diana Vedyashkina, les caniches d’Evelyn Hans, de Viviana, des Chabre ou de Gérard Soules, les boxers footballeurs des Dubsky ou Lola, le basset flegmatique et virtuose à rebours de Douglas Kossmayer alias Eddie Windsor, mais aussi les barzoïs de Marie Molliens ou les partenaires canins du Cirque Aïtal.
Tous les dresseurs du monde sont en quête d’un « sujet », un animal doté d’aptitudes exceptionnelles qui sera à même d’assimiler un nombre de commandements plus important que la moyenne de ses congénères et de se comporter en public de manière presque « surnaturelle ». Le roman Les Baltringues de Ludovic Roubaudi évoque ce thème très particulier avec un chien extraordinaire au cœur de l’intrigue. Entre 1814 et 1820, Munito, un chien calculateur présenté par un hollandais nommé Nief a suscité l’admiration des spectateurs comme des chroniqueurs du temps. Surnommé le « Newton canin », Munito est un caniche blanc toiletté à l’anglaise, c’est-à-dire semblable à un lion miniature. C’est, à l’évidence, un « sujet ».
En s’approchant ainsi de l’homme, quelques animaux d’exception balisent de manière imprévue la question de l’anthropomorphisme et suggèrent un autre niveau d’apprentissage réservé à une « élite » informelle et aléatoire. Surtout, ils permettent d’identifier un autre groupe de bêtes singulières, insérées dans la trame intuitive de nombreuses civilisations.
Représentations
Animal, du latin animalis, est un mot formé à partir d’anima, un terme qui identifie un principe vital, un souffle, une âme. Il évolue progressivement pour identifier un être organisé, doué de vie et de certaines facultés. Appréciés, distingués, mais pas toujours égaux, les animaux évoluent dans les sociétés humaines en fonction des attentes de ceux qui les détiennent, mais aussi selon ce qu’ils incarnent d’une civilisation à l’autre.
Liés au culte de nombreuses divinités, quelques bêtes divisent le règne animal et le stratifient, mais surtout leur intelligence supposée les fait accéder à un système de représentations qui les dissocie définitivement d’une multitude d’espèces moins valorisées.
Peints, sculptés, tissés, brodés, les animaux du « premier cercle » envahissent murs, façades, tentures, tapisseries, étoffes de toutes sortes, mais s’installent aussi en majesté au sein de très nombreux foyers. Là, de l’humble miniature façonnée en terre ou en bois pour l’usage des enfants jusqu’à de somptueuses pièces d’ivoire de bronze, d’or ou d’argent destinées aux crédences ou aux tables de milieu, l’animal se fait roi. De la représentation à l’incarnation il n’y parfois qu’un bond et par la grâce d’auteurs habiles, les bêtes deviennent au fil des pages plus savantes que les hommes. Nul doute que les montreurs itinérants, actifs depuis l’Antiquité, ont joué un rôle, entre émulation et inspiration, pour définir une première structure de caractères et d’attitudes.
Animaux littéraires
Esope, un écrivain grec du VIe siècle avant notre ère, compose plusieurs centaines de fables où les animaux jouent de nombreux rôles. Rassemblées dans un recueil constitué après sa mort, ces fables vont être une formidable source d’inspiration pour de nombreux auteurs, de Phèdre, fabuliste latin du Ier siècle à Djalâl ad-Din Rûmî, mystique persan du XIIIe siècle sans oublier Jean de La Fontaine dont l’œuvre a largement contribué à insérer les bêtes dans l’imaginaire collectif en les parant de traits de comportement familiers et souvent très humains. Des analogies physiognomoniques de Charles Le Brun à l’univers zoomorphe créé par Granville, de La Petite Renarde Rusée de Leoš Janáček à Chantecler d’Edmond Rostand ou de Walt Disney à Georges Orwell, les animaux croisent le fer avec les symboles d’une humanité à la fois puissante et fragile.
Esmeralda, la sémillante saltimbanque qui enchante les pages de Notre Dame de Paris de Victor Hugo, a pour partenaire Djali, une chèvre blanche aux cornes dorées, créature au caractère bien trempé dont les héritières se sont fait une spécialité d’escalader des montagnes de chaises sur les pistes d’innombrables petits cirques dont les portiques ou les chapiteaux s’érigent sur fond de ciel aux premiers beaux jours. Animal au pied agile, créature stoïque, la chèvre se contente de peu et s’avère une bonne recrue pour pimenter une représentation sous les étoiles.

Le roman Sans Famille d’Hector Malot est un jalon déterminant pour requalifier d’aimables créatures en bêtes savantes douées de raison. Le chien Capi et le singe Jolicœur participent de cette vision à la fois idyllique et fantasmée d’animaux rendus plus humains que leurs maîtres par la grâce de leur disponibilité à apprendre à bien se comporter en société. Parés d’atours chatoyants, auréolés par l’auteur d’une intelligence hors norme, ces deux bêtes devenues savantes ancrent leurs semblables dans une parodie d’humanité aussi touchante que ridicule, mais elles marquent aussi le temps de la reconnaissance pour des animaux souvent considérés comme d’aimables serviteurs. Dans un autre registre, Michaël chien de cirque de Jack London, publié à New York en 1917, révèle avec une acuité inattendue les lignes de force et les failles d’un système singulier. Au-delà du brûlot vengeur qui va contribuer à façonner le rejet des sociétés occidentales pour tout ce qui touche aux techniques de dressage, Jack London dénonce sans fioritures des méthodes d’un autre âge et condamne en creux la simple idée de soumission qui pourrait malencontreusement enchaîner deux représentants du même règne. L’ouvrage motive en Angleterre en 1957 la fondation d’une Société pour la protection de l’animal captif qui s’oppose au dressage sous toutes ses formes et milite pour l’abolition pure et simple des ménageries ambulantes et des cirques. Dès les années 1970 la Société fait pression sur les institutions européennes pour promouvoir une harmonisation des législations dans les états membres de l’Union. Le roman de Jack London cristallise une prise de conscience à l’échelle de la planète et motive un autre regard sur l’animal.
En lieu et place d’une fascination éprouvée pour des bêtes capables de se substituer aux hommes pour mieux leur plaire, on préfère désormais évoquer une forme de respect conscientisé, mais qui n’exclut en rien l’admiration.